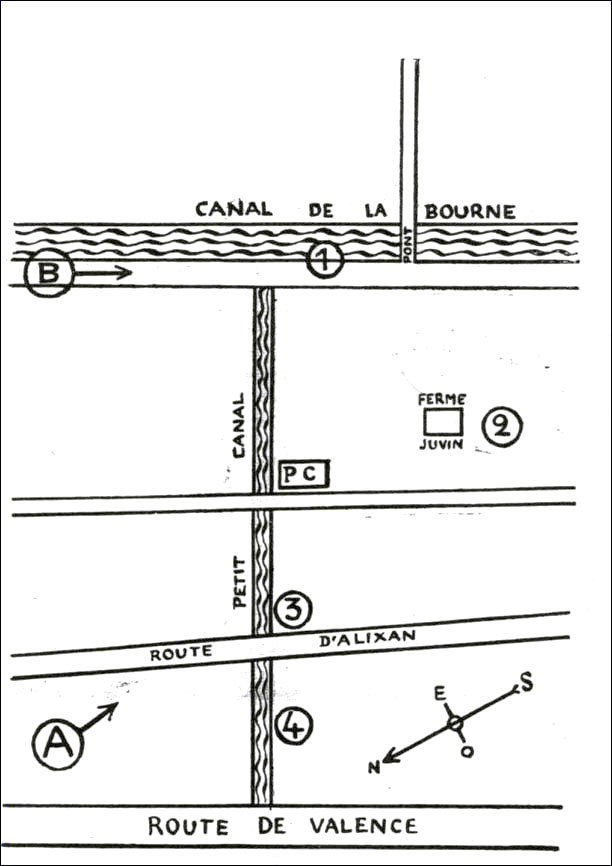Jeanne DEVAL
ROMANS – BOURG DE PÉAGE – PORTES DU VERCORS
6 JUIN 1944 – 6 JUIN 1945
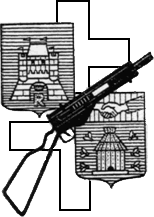
Du débarquement à la libération
6 JUIN 1944
(Journal Daniel)
Depuis quarante-huit heures les nouvelles d’Angleterre sont excellentes; nous sommes en état d’alerte; cela ne dérange en rien nos habitudes, nous en avons tellement eu de ces alertes qui ont avorté ; tout de même celle-là a l’air d’être plus sérieuse.
Vu dimanche, Triboulet, à qui je fais part des derniers renseignements reçus. Je le quitte en lui disant que le débarquement pourrait bien n’être qu’une question d’heures. Vu en fin de soirée, le chef départemental, L’Hermine, qui, toujours traqué par la gestapo a un moral splendide ; il est devenu brun, de face il est méconnaissable, mais de dos je le repère à 100 mètres.
Minuit : de violents coups à ma porte me réveillent en sursaut. Je n’ai pas une arme à la maison, rien de compromettant, mais je me rappelle brusquement que Michel, notre chef de camp de Léoncel a été arrêté dimanche dernier avec son chauffeur par les Allemands. Pourvu qu’ils n’aient pas parlé ; je ne suis pas tranquille. Tant pis, j’ouvre. Je pousse un soupir ; dans l’encadrement de la porte et la bouchant presque, le sous-lieutenant Jeannot, en tenue de campagne est au Garde à vous. C’est lui qui fait tout ce tapage. Encore mal réveillé, il m’apprend que le débarquement aurait lieu ce matin vers 6 heures sur les plages Normandes, et que, comme prévu, l’exécution du plan vert devra être assurée par la compagnie dans la région de Romans. Il me répète deux fois le message. J’en ai le souffle coupé. Un salut, bonne chance et Jeannot part vers Tain pour le même travail ; il n’y arrivera pas ; il rencontre une patrouille allemande au passage à niveau de la route de Tain, qui ouvre le feu ; la voiture passe quand même et Jeannot a une balle dans la tête et son voisin, une dans l’épaule. C’est à l’hôpital de Saint-Donat que je le retrouve le lendemain ; son casque lui a sauvé la vie.
L’annonce brutale en pleine nuit, de ce débarquement me laisse calme. Il faut maintenant que chacun, dans notre groupe prenne ses responsabilités. Tout est prêt depuis plusieurs mois déjà ; nous savons exactement ce que nous devons faire ; il ne s’agit plus que de passer à l’exécution et devenir des « Terroristes ». Tout en m’habillant en tenue de Maquis, je me demande combien nous aurons de défection chez nos hommes. Il ne faut pas oublier que nous leur demandons de tout abandonner, famille, travail, sécurité, qu’aucun de chez nous n’est réfractaire, ils ne viennent se battre que par patriotisme, et tous sont volontaires. Il n’y aura pourtant qu’un pourcentage très faible de résistants du Café du Commerce et tous feront leur devoir.
Mon travail, cette nuit, est simple. Je n’ai que mon adjoint et deux chefs de section à avertir. A leur tour, ils avertiront leurs chefs de groupe, qui feront le nécessaire auprès des hommes.
J’ai un laissez-passer permanent pour la nuit. Je réveille en passant le camarade Chartier pour lui annoncer la bonne nouvelle et l’avertir que nous allons vider le magasin d’équipement et armes, qu’il détient depuis plusieurs mois. Ensuite, je fonce vers la Gendarmerie. Le lieutenant Simon met deux hommes à ma disposition pour me seconder, ce sera plus facile pour circuler. Une alerte vient encore faciliter ma tâche. Je trouve mon adjoint Bourguignon, réveillé et même habillé ainsi que les chefs de section. A 3 heures j’étais de retour chez l’ami Chartier.
5 heures, sac au dos, je quitte la maison ; ma femme a été brave jusqu’au bout ; pas une plainte, c’est pour moi un encouragement. Il ne me reste plus qu’à passer chez Taravello où m’attend depuis un mois une voiture en état de marche. Octave est déjà debout ; il compte aller à sa coupe du côté d’Omblèze ; ma visite lui fait changer d’itinéraire. Il commande une section dans ma compagnie et se met aussitôt à notre disposition.
8 heures : le rassemblement de la compagnie a lieu à Saint-Donat, au château de Marges. Je rencontre en route des hommes de chez nous., en bicyclette ; j’en ramasse deux qui sont à pied dont le jeune Perron qui sera, hélas, quelques jours plus tard assassiné par les Allemands, à côté du château de Marges.
Saint-Donat est en pleine effervescence. Des groupes armés circulent sans se cacher ; j’ai l’impression qu’il est encore trop tôt pour le faire.
12 heures : une bonne partie de la compagnie est arrivée ; les groupes sont constitués. Le lieutenant Bourguignon et les chefs de section ont fait un bon travail, il y a de l’ordre et de la discipline. Nous occupons les communs et une pièce dans le château qui servira de P. C.
Un convoi des camions des chantiers de jeunesse de Romans partant pour Lyon; je mets en chasse l’équipe spéciale de Romans qui arrête le convoi avant Tain et nous ramène au grand complet les camions à Saint-Donat ; nous voilà motorisés.
14 heures : distribution des amies, munitions, explosifs et équipements ; nos hommes sont déjà munis pour la plupart d’un sac tyrolien, qu’ils ont touché au mois d’avril.
Finie la manipulation des armes et explosifs dans les caves. Les hommes s’installent au soleil pour nettoyer leurs armes, pétrir le plastic et préparer les charges d’explosifs, amorcer les grenades. Ils ont tous le sourire de frôler des sacs de plastic, de quoi faire sauter un quartier. Tous ces travaux se font sans imprudence et sous l’œil exercé du chef de section Jansen.
Pendant ce temps, le chef de section Alloncle s’occupe du ravitaillement et des cuisines. Il y aura une bonne soupe ce soir.
18 heures : mise en place de postes de garde pour la nuit. Rapport de la compagnie.
Nous avons comme mission (plan vert) d’interrompre le trafic ferroviaire sur Grenoble. Le Ponceau de Saint-Paul-les-Romans est choisi comme point de destruction.
Il me faut 10 volontaires. Tous se présentent. Nous choisissons 10 hommes, avec armement léger, donnons des instructions très précises, façon de placer l’explosif, etc. Et voilà notre premier groupe motorisé parti faire ses débuts comme terroristes.
A 1 h. 15 le ponceau saute. R.A.S., mission accomplie.
**
6 JUIN 1944
(Journal Yvon)
1 heure. Alerte. La ville est dans une effervescence inaccoutumée. Malgré la D. P. les lumières s’allument dans les appartements. Un homme frappe à la porte. L’ordre de mobilisation du maquis vient d’arriver. Les hommes doivent rejoindre le G. Q. G. de Saint-Donat.
Toujours au nez des boches, chacun est averti. Dans nos rues des silhouettes pressées et chargées longent les murs.
Je vous revois, en moi-même, mes camarades, en ce matin du 6 Juin… Groupés devant la terrasse de ma petite maison, nous attendions le camion qui devait nous emmener vers Saint-Donat… Nous venions de déterrer les armes et vous procédiez à leur nettoyage et à leur montage avec le soin qu’y apportent de vieux soldats. D’autres amorçaient les grenades. Vos visages étaient graves, durs… Nulle bravade, mais une froide résolution y était empreinte : celle de l’homme qui abandonne tout ce qu’il aime, tout ce qui fait sa raison d’être, sa raison de vivre, femme, enfants, biens matériels, ne laissant aux siens ni sécurité, ni, souvent, de moyens d’existence, n’emportant dans son cœur que le souvenir des êtres chers qu’il laisse en danger et la certitude d’accomplir son devoir.
Lorsque nous arrivâmes à Saint-Donat, la ville débordait d’activité. Cette cité qui devait devenir une ville martyre, avait pris un air de fête en ce matin du 6 Juin. Les dissidents gagnaient leur poste de combat… L’animation, la joie des habitants étaient à leur comble. Saint-Donat a été un des centres de la Résistance les plus agissants de la région. Les Allemands le lui ont bien fait payer…
L’avenir devait être dur. Le 9 juin, deux morts et plusieurs blessés marquaient notre premier combat, mais en ce même jour où nous occupions les Allemands à Saint-Donat, cinq cents de nos camarades pouvaient gagner le Vercors où nous pûmes les rejoindre lorsque notre mission, dans cette région, fut remplie.
**
LA MORT D’ANDRE GENY
(Mon Journal)
8 Juin… Des coups de feu viennent de la direction du nouveau pont, « c’est un des nôtres », dit-on, et nous sommes inquiets.
André Geny, un brave à l’inlassable activité, si fier de ce débarquement qui va lui permettre de se dépenser encore davantage pour la cause qu’il sert depuis le début, est descendu de bonne heure du camp de Saint-Donat qu’il a rejoint deux heures avant le débarquement. Il repart en voiture pour ravitailler ses camarades.
Hélas le destin est cruel. Celui qui allait servir la dissidence avec tout son courage et sa volonté tenace est mortellement blessé par sa mitraillette qui se déclenche sous un mouvement trop brusque.
Transporté en grand secret à l’hôpital et enregistré par le chirurgien comme accidenté d’automobile, car les boches veillent, il subit l’amputation d’une jambe… Hélas, la perte de sang a été trop abondante. La gangrène survient et André Geny meurt le lendemain. Il laisse une femme et quatre enfants de 8 ans à 15 mois.
Le lundi, c’est avec le concours de toute la population dissidente, qu’André Geny est conduit au champ du repos.
M. Combe, âme de la Résistance à Bourg-de-Péage, et qui sera plus tard le maire de la Libération, rend hommage au grand dissident fauché trop tôt, alors que son dévouement allait être si utile à la cause de la France.
Et tout cela sous l’occupation allemande. Quelle belle manifestation de courage.
**
A L’APPEL DU VERCORS
(Journal du Capitaine Abel)
Le 8 juin 1944, une conférence réunissait à Rencurel l’E.M. du Vercors ; à l’appel de Clément, les commandants des compagnies civiles de Grenoble, du Vercors, du Royans, de Romans s’étaient précipités, pressentant une nouvelle d’importance. Las ! il fallut rapidement déchanter : Clément présenta les commandants de compagnie au nouveau chef militaire du Vercors, le commandant Hervieux, rendit compte de sa mission à Alger et nous conseilla la patience. « Calmez vos hommes, veillez à ce qu’aucune imprudence ne soit commise, votre temps viendra plus tard ! ». C’est sur ces paroles lénifiantes que nous quittâmes Rencurel. Le vendredi 9 juin, à midi, me parvenait par estafette motocycliste l’ordre suivant :
« Mobilisation immédiate. Mission : verrouillage de la Balme de Rencurel. Liaison demain matin à 6 heures au pont de la Goule Noire. »
Hervieux.
P. C. minuit.
Sans trop d’étonnement, car en ce qui touche le militaire, il est bien dit qu’avant d’exécuter l’ordre, il faut attendre le contre-ordre. Je me précipitai chez Triboulet d’où partirent les premières instructions. Le réseau subtil, tissé avec patience pendant la clandestinité, joua à merveille : par lui furent touchés les chefs de peloton, de section, de groupe, les hommes des dizaines ; en quelques heures s’effectua la mobilisation de la compagnie la plus nombreuse du Vercors. Nous aurions voulu un départ sans tapage, « à la française », comme disent les anglais ; l’impossibilité de concentrer plus de trois cent cinquante hommes sans donner l’éveil aux Boches, la nécessité d’assurer le soir même notre mission à la Balme nous firent opter pour la solution la plus téméraire en apparence, mais la seule à adopter en vérité : « Départ de la gare du tram à Bourg-de-Péage. Premier départ 17 h. 30 à la diligence des chefs de peloton ».
Trois atouts dans notre jeu : le brouhaha d’un jour de marché, la lenteur de la réaction boche, la débrouillardise du Français..
A seize heures me parvient la communication suivante, de source non autorisée heureusement : « Les Boches ont patrouillé toute la nuit à Saint-Nazaire ; ils ont installé des nids de mitrailleuses ». Sueur froide. C’est en raison de ce renseignement que je décide deux Choses : d’abord une reconnaissance sommaire jusqu’à Pizançon que j’effectue immédiatement; ensuite patrouille de touristes précédant le convoi jusqu’à Saint-Nazaire ; feront partie de cette patrouille : Triboulet, Dornic, Reboul et moi.
Ma reconnaissance sur Pizançon ne me laisse pas sans inquiétudes : à hauteur de la Parisière, un sous-officier Boche avec deux hommes en armes ; j’entre dans la maison d’un brave plâtrier et lui confie mon désir impérieux de m’entretenir avec lui quelques instants ; je ne quitte pas. des yeux la patrouille boche qui disparaît par le Pont-Neuf à 16 h. 50.
Sur la route, vers le collège moderne, passent de jeunes gars solides dont le sac tyrolien voile à peine la mitraillette démontée et les grenades. Le groupe franc de Romans rejoint Saint-Nizier.
A partir de 17 heures, de l’Avenue Charles-Mossant à la gare du tram, animation anormale : la concentration des hommes s’effectue, mais celle des moyens de transport ne suit pas le même rythme. Il faut parfois réquisitionner « sans histoire » : une accusation de plus à verser par le bourgeois en pantoufles au dossier de la Résistance! mais ce soir nous faisons litière de scrupules ; j’excuse mes camarades auprès des possesseurs de camions : des centaines d’hommes jouent leur vie ! Le parcours est jalonné par quelques amis sûrs, auxquels l’âge et l’expérience donnent la force réfléchie; à un carrefour j’identifie Georges Sibeud dont la poche est gonflée sans équivoque par un pistolet de gros calibre.
Le premier camion part à 17 h. 30 ; le dernier quittera le Péage à 19 h. 30 et la foule des curieux deviendra si dense que Bonnardel sera obligé d’assurer le service d’ordre, mitraillette à la main ; surestimant non nos forces mais notre armement, les Boches n’ont pas bougé !
Lorsque les premiers gazos passeront à Saint-Nazaire; nous serons rassurés : pas de patrouille, pas de nids de mitrailleuse. Par mesure de précaution j’installe au carrefour des routes venant de Grenoble et allant sur le Royans, un groupe disposant de tout l’armement de la compagnie à savoir : un fusil mitrailleur, quelques mitraillettes, des grenades, protection légère, certes, mais suffisante contre une incursion de la milice ou un camion de reconnaissance. Saint-Nazaire, Auberives, Pont-en-Royans accueillent avec un enthousiasme délirant les maquisards de Romans et du Péage ; dans la nuit, les sections prennent position autour de la Balme de Rencurel ; le lendemain matin 10 juin 1944, à 6 heures, j’étais au Pont de la Goule Noire où le commandant Hervieux arrivait peu après : « Mission accomplie, mon commandant, mais il me faut immédiatement des armes ».
**
ROMANS-VERCORS
par le Capitaine Sambo, chef du 2e Bureau du Vercors
Romans en juin-juillet 1944 était très intimement liée à l’Affaire du Vercors.
Pour des raisons de sécurité et éventuellement pour pouvoir agir hors du Plateau, il fallait que l’Etat-major du Vercors soit exactement renseigné sur la situation et sur tous les agissements de l’ennemi dans tous les départements limitrophes et même dans tout le Sud-est.
Au début juin, les agents du secteur Drôme-Ardèche du Réseau Nestlé-Andromède, dont la base était à Romans, se trouvaient sans liaison avec leur P. C. Ils montèrent dans le Vercors et constituèrent l’armature du Service de Renseignements Militaires, qui, pour notre région, était ainsi organisé :
Chef du S.R.M., Lieutenant Ferlin.
Chef du Réseau Drôme-Ardèche, sous-lieutenant Chevalier.
Informateurs à Romans, Tournon, Valence, Saint-Péray, La Trésorerie, Châteauneuf d’Isère, Livron, Loriol, Montélimar, Ancône, Le Teil, Privas.
Les messages étaient centralisés à Bourg-de-Péage chez les parents de Ferlin, Faye et Fage et de Chevalier.
En cas d’urgence le réseau téléphonique de la Basse-Isère (Romans-Pizançon-Choranche), transmettait directement au P. C. St-Martin et au 2e Bureau.
Il existait aussi un relais téléphonique Romans-La Chapelle, passant par chez M. Gabayet à Saint-Jean-en-Royans.
La liaison téléphonique Saint-Péray-Tournon-Romans était assurée par Roche, architecte à Tournon.
Celle de Valence-Romans à laquelle était rattachée Montélimar-Ancône-Le Teil par la Banque Populaire (M. Nicolas) et par le Comité du Cuir.
Une liaison par courrier Romans-La Balme, était effectuée trois ou quatre fois par semaine par Mlle Jeanine (bicyclette).
A la Trésorerie se trouvaient trois observateurs sur place. La liaison régulière était faite deux fois par semaine par Fage. En cas d’urgence, les observateurs venaient informer à bicyclette à Romans.
Pour donner une idée du fonctionnement de ce service, il est à signaler que lors du combat aérien du 14 juillet, nous avons appris, toujours dans un temps inférieur à 10 minutes, les points de chute des avions abattus. Le pilote de l’avion allemand abattu à Châteauneuf-de-Galaure, nous était amené à La Chapelle le soir même.
Bien entendu, les communications téléphoniques étaient en langage conventionnel variant suivant le correspondant. Par exemple, des tuiles rondes étaient des officiers ; des tuiles plates, des soldats allemands ; des briques, des soldats russes, etc..
Lors de l’encerclement du Vercors, le S.R.M. informa très exactement le commandement sur l’identité des troupes, les effectifs, les points occupés par l’adversaire et sur les moyens dont ils disposaient.
Un grand nombre des volontaires du Vercors étant des Romanais-Péageois, il y en avait certainement plus de 700, la question de la sécurité des familles qui étaient restées à Romans, posait un grave problème. Fallait-il arrêter ceux dont on craignait les dénonciations et se procurer des otages qui éventuellement permettraient d’intimider les traîtres ? N’allait-on pas ainsi déclencher des représailles et provoquer précisément ce que l’on redoutait ? Deux incidents dans cet ordre d’idées eurent de sérieuses répercussions à Romans : la tentative d’arrestation de José, décidée par le 2e Bureau, sur les instances de la Compagnie de La Balme et l’arrestation de Mado, maîtresse du milicien Arnaud par un groupe franc agissant sans ordre.
Une organisation romanaise complexe s’occupait de la distribution du courrier des maquisards et de la centralisation des lettres destinées aux volontaires. Un autre organisme fonctionnait pour distribuer des secours aux familles. De nombreuses personnes se dévouèrent et se compromirent pour cela.
L’argent faisait défaut au Vercors, car les fameux parachutages des millions ne furent malheureusement qu’une légende. Les colonels Bayard et Hervieux demandèrent à certains romanais d’organiser, quelque chose à Romans pour emprunter les crédits qui leur étaient nécessaires. Ils signalèrent un banquier romanais dont ils connaissaient les sentiments et qui leur paraissait à même de réaliser un emprunt important auprès des industriels de Romans.
Ce banquier, convoqué par l’Etat-Major du Vercors, se chargea de cette réalisation.
**
L’EXECUTION DES CROZES
(Renseignements Régeon et Valero rescapés de l’exécution)
(Mon Journal)
Vendredi 9 juin. Un groupe franc est en mission depuis quelques jours afin de trouver des voitures pour les besoins du camp. Quatre ont pu être récupérées et camouflées au lieu dit le Vieux Moulin. Ce vendredi matin l’une d’elles est prête. C’est une Renault transformée en camionnette. Trois hommes et le chauffeur l’occupent, il s’agit de Vallayer, Baboit, Valéro et Régeon. Là, laissons parler nos jeunes rescapés.
« Nous démarrons à 9 h. 45, vers 10 heures nous nous trouvons au lieu dit « les Crozes », des miliciens font un barrage. Nous essayons cependant de passer mais l’un d’eux, le chef Arnaud siffle les Allemands et les miliciens qui se trouvent non. loin de là. On nous donne l’ordre de descendre les mains en l’air et on nous conduit sur le bord de la route.
Au même moment deux motocyclistes sont arrêtés dans les mêmes conditions que nous. Ce sont les chefs d’un camp installé à proximité : Jean Joseph, de Valence, et un Lieutenant non identifié.
L’officier allemand vérifie le contenu de la voiture : il y a 3 grenades et 4 mitraillettes. Fou de rage il s’écrie : « Grenades, vous terroristes, Kapout ».
Sur ces entrefaites un cycliste venant de St-Donat est à son tour arrêté et aligné auprès de nous ; son vélo est broyé à coups de crosse.
Nous voilà donc tous les sept sur le talus attendant notre exécution. Un soldat boche fouille nos poches et alors qu’il s’approche du dernier (notre camarade Baboit), celui-ci avec un sang froid inouï bouscule le boche et s’enfuit. Des rafales de mitraillettes sont tirées dans sa direction, mais il passe au travers. Craignant que Baboit avertisse les dissidents les boches tirent aussitôt dans notre direction deux rafales en éventail.
Tous s’affaissent mais tous ne sont pas touchés à mort. Valéro a deux balles dans la cuisse ; Régeon quatre à l’épaule à 2/10e de millimètre de la colonne vertébrale et deux dans la jambe : Vallayer est affreusement blessé au visage. Pendant 3 h. 10, perdant leur sang, Valéro et Régeon font les morts, mais à bout Régeon appelle, Valéro répond, Vallayer geint. Miracle ! ils sont vivants, mais à côté, hélas, leurs trois camarades ont cessé de vivre.
Arnaud et d’autres miliciens répondent aux appels et dans l’espoir d’obtenir des aveux transportent les trois rescapés à la caserne Bon à Romans. Ils sont interrogés par 9 français de la Gestapo de Lyon et un allemand. Vallayer, dont l’état est grave, est gardé dans une pièce au rez-de-chaussée, c’est en dehors de la présence de leur camarade que Régeon et Valéro parlent. Ils parlent en effet, mais racontent une petite histoire qui leur sauve la vie et ne compromet en rien la dissidence : « Ils avaient emprunté ce camion pour se rendre au travail, ils ignoraient qu’il s’agissait de terroristes.
La Gestapo y a cru et c’est heureux car Valéro et Régeon devaient être achevés le lendemain à 5 h. 30, dans la cour de la caserne.
Ils furent donc transportés à l’hôpital de Valence pour y être soignés comme civils, mais sous condition toutefois qu’ils regagneraient l’Allemagne à leur guérison.
Vallayer, conducteur de la voiture aura une défense difficile ; d’autre part, il est très faible. Chaque fois que ses camarades s’inquiètent de son sort : on s’en occupe », leur répond-on.
On s’en occupait bien en effet.
Trois jours après, un petit berger trouvait son corps au fond d’une carrière près de St-Lattier. Les barbares l’avaient achevé d’une balle en plein cœur.
Régeon et Valéro disparurent rapidement de l’hôpital de Valence ; Régeon dut se soigner longtemps d’une blessure très grave. Valéro regagnait seul le Vercors et à la libération s’embarquait pour la Californie, Baboit est toujours sergent dans l’armée régulière.
Vallayer, hélas, repose sous une croix de Lorraine au cimetière de Romans. Avec son nom évoquons aujourd’hui la mémoire des trois camarades tombés à ses côtés.
**
LES BOCHES A SAINT-DONAT
(Mon Journal)
Le 15 Juin, dans la matinée des camions allemands traversent Romans. Nous tremblons à la pensée que nos F.F.I vont être attaqués car nombreuses familles ont un des leurs là-haut. L’avion mouchard passe et toute la journée nous sommes inquiets.
Vers 17 heures les mêmes camions redescendent chargés de vélos, de postes, de linge, de quartiers d’animaux de boucherie.
Nous apprenons bientôt que St-Donat a été envahi par toutes les routes qui y arrivent ; les maisons ont été visitées, 57 viols ont été commis, tous les toits et les murs ont été criblés de balles, nombreux otages ont été emmenés, reviendront-ils ?
Là encore, selon leur habitude les nazis s’en étaient pris à la population civile.
**
RENE JUVEN DES GROUPES FRANCS F. T. P.
EST BLESSE DANS UN COUP DE MAIN
(Mon journal)
Le mercredi 28 juin, René Juven et cinq camarades rodent en ville. Il faut un camion. C’est urgent et coûte que coûte ils exécuteront l’ordre du chef. Les maquisards trouvent à la gare un camion de la minoterie Ferrier. Les hommes sont en train de charger des farines.
René Juven, après avoir donné rendez-vous à ses camarades face au café de France, monte sur le marchepied du camion et intime au chauffeur l’ordre de prendre la direction de Bourg-de-Péage, ce qui se fait le plus naturellement du monde sans éveiller l’attention de personne.
Hélas, le père du Milicien Ferrier, propriétaire du camion, rodait aussi. Il prend aussitôt un vélo, suit le véhicule et arrive à Bourg-de-Péage au moment où René Juven faisait arrêter ce dernier pour prendre ses camarades.
– Que faites-vous dans ce camion, dit le propriétaire ?
– J’emporte la farine au maquis, répond Juven sans se départir de son calme.
Au même instant, à bout portant, Ferrier fait feu sur René Juven avant que celui-ci n’ait eu le temps de tirer. Il reçoit quatre balles dans le corps, réagit, tire à son tour, mais son agresseur s’est dissimulé derrière le camion et René Juven perdant son sang s’enfuit à toutes jambes vers la clinique du docteur Eynard. Ses camarades le rejoignent bientôt L’A. S. est alertée et la clinique gardée pendant l’intervention pratiquée par le docteur André Morel et qui consiste à extraire une balle du poumon gauche.
René Juven est ensuite transporté, toujours à la barbe des. boches à St-Martin-en-Vercors où le docteur Ganimède pratique une nouvelle intervention, car René Juven avait encore une balle dans le poumon droit.
Malgré ses blessures, René Juven désire guérir. Il fait preuve d’une énergie, d’un courage extraordinaires. Bientôt, hélas, encore convalescent, il voudra reprendre de l’activité… et ne pourra malheureusement pas servir jusqu’au bout, la dissidence. Il sera fauché par les balles nazies.
**
LE GROUPE DANIEL REJOINT LE VERCORS
(Journal Jansen)
Le 25 juin, l’agent de liaison André Bourguignon, remet au chef Piron (Daniel), l’ordre suivant :
Bayard à Piron. (25 juin 44).
J’ai la chance d’avoir auprès de moi en ce moment le Commandant Marten. Celui-ci ne voit aucun inconvénient à la venue de votre groupe dans le Vercors. Je vous réitère donc l’ordre de rejoindre le Vercors dès le reçu du présent papier.
Le Commandant Marten signe avec moi cet ordre.
Amicalement.
Signé : Bayard.
Commandant Marten.
Bayard est le Colonel Descours, actuellement Gouverneur militaire de Lyon ; le Commandant Marten, un Commandant anglais parachuté).
Montmiral, 29 Juin. Dès le lever du soleil, toute la compagnie part dans les bois d’où se forment les convois pour le Vercors. En tête, une camionnette avec le chef du convoi Louis Chartier. Une moto vient ensuite, puis la conduite intérieure des chefs Daniel et Bourguignon et les trois camions. Tous les véhicules, espacés de trois à quatre cents mètres les uns des autres. Itinéraire : St-Etienne-de-Montagne, St-Lattier, Pont d’Eymeux, St-Nazaire. La route est admirablement bien jalonnée par les amis de Romans. Arrivée à Pont-en-Royans : barrage, nombreuses chicanes par les dissidents qui occupent lès positions sur toute la route allant de Pont-en-Royans à la Balme-de-Rencurel, contrôlant ainsi l’entrée du Vercors à l’ouest.
A la sortie de Pont-en-Royans, le convoi ayant été signalé, une dizaine de chasseurs de la Luftwaffe attaquent notre arrière-garde. Tous les hommes sautent des camions. Ne possédant pas d’armes anti-aériennes nous faisons mettre en batterie les F. M. anglais. Nous voyons les chasseurs surgir des rochers, lâcher leurs bombes, mitrailler la route. Par la faute d’un mouchard, Pont-en-Royans, St-Jean-en-Royans, St-Nazaire sont bombardés. Le convoi y échappe de justesse. Arrivés à la Balme nous rencontrons le Lieutenant Marc, Ermacora, Tonneau, Martin, Laurent, William. L’accueil est enthousiaste, quoique les gens soient .un peu affolés, car c’est le premier bombardement sur la région. Là, les patriotes nous prennent, avec nos tenues improvisées, pour des troupes régulières américaines.
Demain, nous occuperons des avant-postes dominant la route rive gauche de l’Isère et St-Marcellin.
**
LA MILICE A ROMANS
(renseignements Brigadier de la Paix Martin)
(Mon journal)
Nous étions habitués à voir arriver la Milice. Ce n’était pas toujours drôle. Nous préférions les Boches. C’était des ennemis, mais des Français, dont il fallait se méfier c’était vraiment écœurant !…
Dimanche 9 Juillet. A 11 heures une belle conduite intérieure s’arrête devant le Commissariat. Un grand jeune homme, fort beau garçon d’ailleurs, un « ancien chantier » en sort. C’est Arnaud, le milicien qui a quitté les chantiers pour cette triste besogne de délateur et de bandit. Quatre autres miliciens le suivent. Il tient en respect avec une mitraillette sur le ventre le chef de poste Vergier. Pendant que ses camarades surveillent les autres hommes de la brigade, Arnaud intime l’ordre de faire publier par tambour, que si dans vingt-quatre heures sa fiancée (! ! !) n’est pas retrouvée (des dissidents l’avaient enlevée la veille), cinq hommes seraient fusillés devant Jacquemart. Il remet au Commissaire la liste des noms des personnes à arrêter. D’autre part, si dans une heure, Tordre n’était pas exécuté, les quatre agents de garde seraient également abattus. Là-dessus, Arnaud quitte le poste disant qu’il se charge lui-même du dernier de la liste en question… c’était Victor Boiron.
Une demi-heure après on apprend que les miliciens se sont trompés de maison et ont gravement blessé M. Ferlay, voisin de M. Boiron.
L’exaltation est à son comble. Mme Boiron, comme tous les dissidents et familles de dissidents est habilement avertie par les agents. M. Triboulet et le Capitaine Vincent figuraient aussi sur la liste.
Mme Vincent et son fils venaient de fuir par la cour de l’école quand la Milice se présenta à leur domicile. C’est Mme Vergnon qui reçut Arnaud et l’évinça au mieux. Là encore, les agents avaient fait du bon travail.
Non contents d’avoir blessé un tranquille romanais absolument étranger à son affaire, Arnaud et ses compagnons vont arrêter Mme « Grandsire », cafetière rue St-Nicolas dont le mari est agissant dans le Maquis. Là encore, il est à craindre pour sa vie. Au poste de police, menacée, frappée, la jeune femme est prise d’une violente crise nerveuse, ce qui permet aux agents, avec la complicité d’un docteur, de la faire hospitaliser… puis disparaître peu après.
Dans l’après-midi, la demoiselle « Mado » n’est toujours pas retrouvée. « L’amoureux désespéré » menace de faire le carnage annoncé. Les agents tentent de téléphoner à Valence à la Milice. Peu après, un chef arrive. On demande de surseoir, la fille volage ayant pu disparaître volontairement. Le chef calme Arnaud.
Par la suite la fiancée (!!!) regagne Romans.
Nous préférions cela.
**
LA GESTAPO A BOURG-DE-PEAGE CHEZ M. LAPIERRE
(Mon journal)
Le 11 Juillet, à 15 h. 30, plusieurs voitures s’arrêtent au domicile de M. Lapierre, forain, à Bourg-de-Péage. C’est la Gestapo.
Les hommes demandent M. Lapierre. Il est à son jardin, au quartier de la Maladière. Mme Lapierre est sommée de monter dans la voiture et d’accompagner « ces Messieurs » auprès de son mari.
Là, M. Lapierre a bien vite compris ce dont il s’agit car les balles sifflent de toute part. Les allemands ayant renforcé les agents de la Gestapo, M. Lapierre fuit par les champs et on perd sa trace à la Bourne qu’il traverse pour échapper aux balles.
C’est alors que Mme Lapierre est reconduite à son domicile où son neveu, maquisard de la première heure, descendu du Vercors à l’hôpital pour enlever des blessés qui craignent d’être inquiétés, se repose, ignorant complètement la première visite. Il est évidemment arrêté et emmené avec sa tante au siège de la Gestapo, à Valence.
Là, tous deux sont sévèrement interrogés. Le neveu est frappé jusqu’au sang ; il passe au supplice de la baignoire, mais ne parle pas. Mme Lapierre reste très courageuse et ne se démonte jamais.
On veut leur faire avouer la présence d’un dépôt d’armes et donner les noms des chefs dissidents. La Gestapo n’arrivera pas à ses fins.
Le lendemain 12 juillet, les allemands reviennent à Bourg-de-Péage, se rendent au domicile. Ils fouillent, pillent. Toutes la journée des camions entiers de marchandises prennent le chemin de Valence.
Le 13, les meubles sont détériorés à coups de haches et l’incendie est allumé. Fort heureusement les pompiers ont pu maîtriser le feu avant qu’il ne prenne des proportions qui eurent été catastrophiques pour un quartier tout entier.
M. Lapierre, pendant ce temps a gagné le maquis ; Mlle Lapierre, fort heureusement absente ce jour-là est, sur l’initiative du docteur Eynard et de M. Daubanay, confiée à M. Vicat, maire de Mours qui l’accompagne à St-Martin-en-Vercors où le docteur Ganimède et Jésus Bès vont veiller sur elle.
Mme Lapierre et son neveu sont transférés à Bellecour, puis à Montluc.
A Romans, circulent les bruits les plus divers. On croit longtemps que Mme Lapierre a été tuée par la Gestapo. Ce n’est qu’à la libération que nos deux prisonniers regagnent leur petite patrie.
**
LE 14 JUILLET
(Mon journal)
Dans le ciel d’un bleu parfait, dès huit heures, des escadrilles de l’aviation américaine survolent toute la région. Les papillons argentés se détachant sur le bleu pâle d’un beau ciel d’été font penser à une parade militaire. Le 14 Juillet peut-il en être autrement ?
Là-haut sur nos montagnes des armes sont jetées. De toute part se déploient des parachutes tricolores pour commémorer dans le ciel, cette fête de la liberté interdite par l’occupant.
Les Romanais assistent durant une heure à de violents combats aériens. Deux avions boches sont mortellement atteints. Un avion américain tombe dans la région de Châteauneuf-d’Isère. Les boches partent aussitôt pour tenter de capturer les pilotes descendus en parachute. Mais la Dissidence aussi veille. Ses voitures connaissent mieux les positions et les deux pilotes sont rapidement mis à l’abri par un groupe dissident après avoir été habillés en civil par M. Chatelat, le sympathique instituteur des Balmes. Un avion allemand s’abat sur la commune de Mureils, entre les villages de Mureils et de St-Bonnet. Le pilote, un caporal-chef de la base aérienne d’Aix-en-Provence, venait d’avertir téléphoniquement les siens quand il fut capturé vers 10 h. 30 par Bozambo des camps du Larris et son adjoint Philippe, et conduit immédiatement à la Chapelle-en-Vercors.
L’après-midi, vers 14 heures, deux camions chargés de soldats font irruption à Châteauneuf. Les boches se rendent près de l’avion abattu et constatent l’absence des armes de bord (elles seront retrouvées par la suite) et la disparition du pilote. Après menaces et représailles à l’encontre des spectateurs présents, ils se répandent dans les fermes environnantes et s’y restaurent.
Vers 16 heures, les boches s’embarquent. Départ en direction de Mureils. Une demi-heure après, une fusillade nourrie annonce leur retour à Châteauneuf-d’Isère. L’affolement règne. Quelques personnes réfugiées dans le café P. Graillat s’en échappent et pensent pouvoir se cacher dans un champ de blé proche. Malheureusement elles ont été aperçues. Les armes crépitent et les grenades s’abattent sur elles. Perquisition ; défense de toucher aux morts ; promesse de revenir dans la soirée, tout est mis en œuvre pour terroriser la population. Les boches disparaissent enfin et on va pouvoir dénombrer les victimes.
Cinq morts sont à déplorer : Tosi, réfugié lorrain ; Bruno, italien ; Jean Sauvageon, garde-champêtre ; Bret, coiffeur, réfractaire au S. T. O. et le jeune Michel Morette, âgé seulement de 14 ans. Leurs funérailles auront lieu le dimanche 16 juillet au milieu d’une énorme affluence. Trois blessés sont relevés : Dodo Brun, Marius Noir et Marcel Thon grièvement atteints.
Pendant que ces incidents se déroulent dans la plaine, des avions allemands étaient apparus sur la montagne. Vers neuf heures, par groupe de trois ou quatre, se relayant pour aller faire leur plein à l’aérodrome, les avions allemands lancent leurs engins sur la Chapelle-en-Vercors. Et cette ronde infernale dure pendant 12 heures. Les appareils venant et repartant par le nord-ouest. Quinze bombes explosives causent d’assez gros dégâts. Elles sont suivies de plusieurs milliers d’engins incendiaires.
L’agglomération et la campagne environnante sont littéralement arrosées de projectiles en même temps que les mitrailleuses crépitent à basse altitude. Et la population, cachée dans les forêts voisines assiste impuissante à l’anéantissement de son village.
Le même jour, à seize heures et pendant quinze minutes des avions allemands déversaient mille engins incendiaires sur la paisible cité de St-Jean-en-Royans.
En cette soirée, quelques groupes de maquisards, les derniers, regagnaient la montagne.
Mémorable 14 Juillet !
**
MORT DE RENE JUVEN DES F. T. P.
(Mon journal)
19 Juillet. Trois semaines après l’incident de la place du Marché où René Juven avait été grièvement blessé… notre bouillant maquisard est volontaire pour une mission à Romans. Il est heureux à la pensée de pouvoir en même temps embrasser sa femme et sa fille qui ne l’ont pas revu depuis l’accident. Mais voilà que sur la route de Saint-Nazaire le camion est en panne et n’arrive à Bourg-de-Péage qu’après le couvre-feu. René Juven devra se rendre chez lui avec précaution car les patrouilles boches veillent. Il quitte ses chaussures et sans bruit longe les rues. Arrivé face au Café de France il va emprunter la rue des Addoux quand, dans l’obscurité des ombres s’avancent. Ce sont les boches. Il est 23 h. 30. Une fusillade nourrie met en émoi les romanais et péageois. « Encore un malheur, pense-t-on ». En effet, malgré les sommations de la patrouille boche René Juven essaye de fuir… mais le chien policier qui accompagne les allemands l’arrête. De toute façon Juven sait qu’il est perdu. Il tire en direction des frigolins. En retour des rafales de mitraillette le couchent à terre à l’endroit même où, trois semaines auparavant il avait été blessé…
**
L’INCIDENT DU 20 JUILLET
(Mon journal)
Le 20 Juillet, à 14 h. 15, une voiture de tourisme Citroën traction, matricule FA3 6011 et dans laquelle ont pris place trois hommes et une femme appartenant au maquis va franchir le passage à niveau de la Route de Mours, se dirigeant sur Romans, quand des soldats allemands en embuscade tirent un feu nourri dans sa direction. Le conducteur, un brave romanais Richard Pietrzinski et son compagnon sont tués, les deux autres occupants blessés.
Notre sympathique chef de gare offre des pansements pour les blessés qui les bras en l’air perdent leur sang en abondance. L’Allemand le met en joue disant : « Nicht ! Nicht ! » et le force à se retirer.
Les blessés restent quarante minutes en plein soleil, perdant leur sang, puis, un camion Allemand prend en remorque la voiture à l’intérieure de laquelle se trouvent les morts ; les deux blessés sont hissés dans le camion sans avoir été pansés et, en route pour la caserne Bon.
Là, pour être plus complets, nous laisserons parler le gardien de la paix Armand Quais.
« Vers 16 heures, alors que je remplaçais le brigadier, comme chef de poste, un adjudant allemand se présenta au commissariat, me déclarant que deux camarades français terroristes venaient d’être tués par les troupes allemandes et se trouvaient à la caserne Bon, qu’il fallait faire le nécessaire pour l’enlèvement des cadavres. Il me dit ensuite que le commandant allemand désirait voir immédiatement le Maire de Romans. Je fis le nécessaire auprès des Pompes Funèbres et j’avisai M. Barlatier des désirs du Commandant allemand.
A 17 heures, j’arrivai à la caserne Bon, précédé de Monsieur le Maire. Là, nous avons été introduits auprès de l’officier allemand commandant la garnison. Celui-ci s’adressant à M. le Maire, lui dit :
« Etes-vous au courant de l’incident qui vient de se produire entre soldats allemands et terroristes ?
– Non, n’est-ce pas. Vous ne voulez pas être au courant. Cependant moi, je sais que tous les jours, les terroristes viennent et circulent librement dans Romans, sans être inquiétés. Et vous, Monsieur le Maire, vous êtes leur complice.
Et s’adressant à moi, le commandant ajouta :
– Quant à vous, la police, vous êtes avec les terroristes. Je dirai même que vous êtes des terroristes. Car non seulement vous ne faites rien pour les arrêter, mais vous les aidez à travailler contre les troupes d’occupation. Je suis au courant de tout ce qui se passe à Romans. J’ai les preuves en mains, c’est ainsi que des industriels dont je ne connais pas encore les noms ont versé des sommes allant jusqu’à 5.000 francs pour venir en aide aux familles de ces bandits, qui sont dans la montagne. Eh bien, j’en ai assez ; je vais vous mettre au mur. Vous savez ce que cela veut dire : je vous ferai fusiller. »
M. Barlatier répondit à l’officier que, les sommes versées par les industriels de Romans, étaient destinées aux familles nécessiteuses de cette ville.
L’officier allemand lui répondit :
– Je vous répète que vous êtes complices de tous ces agissements.
Et continuant :
– Monsieur le Maire, à partir d’aujourd’hui, je vous rends responsable du moindre incident qui se produira à Romans. Ce sera un malheur pour vous et vous pouvez prévenir dès à présent la population de Romans et de Bourg-de-Péage que je ferai bombarder ces deux villes en cas d’incidents. J’ai encore assez de canons et d’avions à ma disposition et si je veux, dans deux heures, les deux villes seront réduites en cendres.
Messieurs vous êtes libres. Vous pouvez disposer. »
**
LE SIEGE DU VERCORS
(Mon journal)
Vendredi 21 juillet, les Allemands se pressent sur toutes les routes. Ils encerclent le Vercors, dit-on. Dans la soirée la radio anglaise annonce la terrible nouvelle : 3 divisions allemandes dont une blindée cernent le Vercors.
L’avion « mouchard » passe tous les matins, puis les Messerschmitts survolent et l’on entend au loin les bruits sourds, des bombardements. A chaque vibration le cœur des épouses et des mères bat à se rompre. Le courrier s’échangeait hier encore entre Romans et là-haut, mais les missives d’aujourd’hui ne partiront pas. Les allemands sont signalés à Saint-Nazaire, Izeron ; plus rien ne passera désormais. On ne sait rien et treize longs jours abominables vont s’écouler.
**
INQUIETUDE !
(Mon journal)
25-26-27-28 juillet. – De tous côtés arrivent des maquisards en déroute qui font du Vercors le tableau le plus affolant : il ne reste plus personne ; tous les dissidents ont été exterminés ; on les écorche vivants ; ceux qui sont dans les bois meurent de faim… D’autre part, assez officiellement, on apprend que les Allemands ont atterri en planeurs à Vassieux et que les troupes de terre ont pu pénétrer dans la montagne par Herbouilly. Les Boches pillent et brûlent tout sur leur passage. On chuchote des noms de fusillés… On sait que ceux qui essayent de franchir l’Isère pour fuir sont mitraillés dans l’eau et pour la plupart noyés.
Devant la population, les femmes inquiètes se font un visage souriant. Elles gardent une attitude digne et surtout confiante… Elles placent cette confiance là où leur conviction le leur demande. Cette foi est nécessaire dans la lutte quotidienne menée par les épouses et les mères de la Résistance.
**
LES FOYERS DISSIDENTS TRAQUES
(Mon journal)
Pendant ce temps l’inquiétude est encore alourdie par la présence des Boches qui, venus de Saint-Nazaire en camions blindés, visitent les maisons des maquisards.
Leur premier exploit est de faire sauter la boulangerie de Madame Rey, rue Saint-Nicolas dont le mari est prisonnier et le fils au maquis. Puis dans cette journée du 31 juillet c’est chez les dissidents Ganimède, Claudet fils, Descombes. Tout est pillé, détruit, brûlé. On signale de nombreuses arrestations. Tous les appartements des agents de police maquisards sont également pillés ; quelques femmes sont emmenées.
A Bourg-de-Péage des opérations semblables se déroulent. A l’épicerie Satre, à la boucherie Bart, au café Clerc. Dans l’appartement de MM. Vincent et Vergnon ; la ferme de M. Chaloin à Cham-bois est complètement incendiée.
MM. Satre et Chaloin ainsi que Mme Clerc sont arrêtés. MM. Argod et Chatelan de l’usine Mossant sont emmenés une journée à Saint-Nazaire sous l’inculpation de détention de dépôts d’armes.
**
ARRESTATION DE MM. SATRE ET CHALOIN
(Journal A. Chaloin)
C’est la gendarmerie allemande conduite par la milicienne Mireille Provence sous les ordres et en présence du féroce et trop célèbre Oberland qui a mis le feu à ma propriété. J’avais sous mon toit un officier de la dissidence, le lieutenant Satre dont l’épicerie avait été saccagée le jour précédent.
Le 4 août à 17 heures, une torpédo armée de mitrailleuses dans laquelle se trouvaient Oberland, Mireille Provence et un sous-officier, et un camion avec une quinzaine de boches se dirige vers la maison. Les voitures ne sont pas encore arrêtées que les hommes en descendent et tirent un feu nourri sur Satre qui se sauve dans les maïs derrière le bâtiment de la ferme. La propriété est cernée de toute part. Mon camarade et moi sommes arrêtés.
Les boches pillent tout ce qui les intéresse, puis mettent le feu. Ils ne quittent les lieux que lorsque le toit tombe. Rien ne peut donc être sauvé.
Les allemands nous emmènent et se font conduire à l’école de filles de Bourg-de-Péage au domicile de MM. Vincent et Vergnon. Là encore tout est saccagé et pillé. Après une courte visite chez Saraillon (celui qui dénonçait les patriotes pour un morceau de pain), nous sommes conduits à l’école de Saint-Nazaire transformée en prison. Là nous sommes ligotés pour être dirigés le lendemain sur la caserne de Bône à Grenoble. Nous sommes les derniers prisonniers de Saint-Nazaire. Les exécutions avaient lieu le 3 ; le 5, le quartier général allemand partait. Une fois entrés dans les cachots de Grenoble, d’après les déclarations d’Oberland nous ne devions pas revoir le jour, mais, par une ruse, je réussis à me débarrasser de mes liens et à déligoter Satre.
Les boches cherchent pendant deux jours les prisonniers qui étaient entrés ligotés mais ne les trouvent pas. Ils viennent même jusque dans notre cellule, mais comme ils ne nous appellent pas par nos noms jamais nous ne répondons.
Je crois que c’est à ce tour de force que nous devons la vie.
**
DELIVRANCE ET DOULEUR
(Mon journal)
Samedi 5 août. – Dès les premières lueurs du jour, les canons et tout le matériel allemands descendent du Vercors en direction de Lyon.
Le téléphone jusque là entièrement interrompu depuis le siège du Vercors est partiellement rétabli. Cette fois plus de doute ; ils repartent.
Il faut être aussi lourd qu’un boche pour ne pas voir dans tous les regards des dissidents cette flamme victorieuse.
Mais hélas ! les mauvaises nouvelles arrivent aussi avec ce départ… Beaucoup des nôtres sont tombés. 27 maquisards ont été fusillés à Saint-Nazaire dans la cour du château. Dans tous les villages ce fut atroce. A Vassieux 72 civils sans distinction femmes, enfante, vieillards ont été tués. Sur 150 maisons, deux seulement sont debout, mais pillées et sans cheptel. A la Chapelle, tout ce qui subsistait du village après le bombardement a été incendié. Dix-sept jeunes… dont la plupart ont des noms familiers sont tombés, lâchement assassinés par les nazis.
8 août. – Depuis deux jours, nos maquisards amaigris arrivent fourbus. Inquiètes, les épouses et les mères attendent. Çà et là, au nez des Boches, chacun réintègre le foyer. Pour certaines c’est la détente, le soulagement, la joie.
En égoïste, on se laisse aller à ce bonheur dont on avait douté-Mais une émotion étreint certaines à la pensée de celles qui ne les verront pas revenir et, comme honteuses d’être privilégiées du sort, elles contiennent leur joie.
**
MIREILLE PROVENCE
(Renseignements communiqués par les Pionniers du Vercors)
Il est utile de parler ici de l’ignoble Mireille Provence qui tint en notre région une place de premier plan comme instigatrice des perquisitions allemandes dans nos deux villes et dénonciatrice des dissidents fusillés à Saint-Nazaire.
Mireille Provence, de son véritable nom Mireille Varo, épouse Reboul fut arrêtée le 12 juillet 44 par un corps franc du maquis de Chartreuse, d’après les renseignements fournis sur son activité antinationale par le Service Départemental de l’Isère M.U.R. et aussi d’après ses agissements dans la région. Elle a été arrêtée à Paladru et après interrogatoire transférée à la Chapelle-en-Vercors par le Lieutenant Robin, adjoint au Commandant de Collomb, chef du secteur 2 du maquis de Chartreuse.
Elle fut emmenée ainsi que son amie la fille Gachereau à la Chapelle-en-Vercors dans la nuit du 12 au 13 juillet 44. Mais le rapport concernant son arrestation n’étant jamais parvenu au 2e Bureau du Vercors, aucune mesure spéciale ne fut prise contre elle. Au contraire, ayant déclaré être enceinte elle fut examinée par le Docteur Gaillard qui reconnut la véracité de ses dires et elle bénéficia d’un régime alimentaire spécial.
Par suite du bombardement du 14 juillet le camp fut transféré aux Drevets, puis à Loscence pour éviter les attroupements visibles par les avions ennemis. Les détenus, femmes et hommes, passaient la journée en forêt sous la surveillance des gardiens, ne rejoignant le cantonnement qu’à la nuit.
L’Etat-Major du Vercors ayant donné l’ordre de libérer le camp, les deux femmes quittaient Loscence le 22 juillet.
Elles rejoignaient alors Saint-Nazaire. Là, elle se mit à la disposition des allemands et devint la maîtresse de l’Oberleutnant Rudolph Selbrich, plus connu dans notre région sous le nom de Commandant Oberland. C’est ainsi que nous le nommerons désormais.
Là commence son rôle infâme. Siégeant à côté du Commandant Oberland, sur lequel elle paraissait exercer une influence extraordinaire (témoignage de Mme Clerc), elle prenait une part active aux interrogatoires des soldats du maquis que les allemands arrêtaient lors de leur tentative de traversée des lignes boches. Douée d’une intelligence très vive, Mireille Provence avait un véritable don pour confondre ces malheureux. Nombre d’entre eux que le Commandant Oberland s’apprêtait à relâcher, furent rappelés et condamnés sur un détail infime dont elle seule s’était aperçue (chaussures de formes américaines et chaussures acajou destinées à la Milice et qui avaient été prises aux usines Banc de Romans).
Vingt-neuf de ces malheureux furent donc exécutés et elle porte incontestablement la responsabilité de leur mort.
Parmi les prisonniers, elle fit la connaissance d’un nommé Saraillon dont elle devait faire par la suite son auxiliaire et qui devait l’accompagner dans ses expéditions dans Romans-Bourg-de-Péage.
Elle déclara à cette période au Docteur Gaillard de Vaison-la-Romaine également ex-détenu de la Chapelle qu’elle avait l’intention de faire arrêter une dizaine d’officiers et sous-officiers du Vercors dont elle lui confia les noms. Dès qu’il fut libéré le Docteur Gaillard put les prévenir, ce qui fit en partie échouer l’expédition qu’elle dirigea personnellement avec le Commandant Oberland à Romans et à Bourg-de-Péage. Le dimanche 30 juillet 44, en compagnie de Saraillon, elle commençait ses investigations. Vers 3 heures de l’après-midi, se faisant passer pour infirmière du Vercors, elle interrogeait habilement au Café Marius à Bourg-de-Péage plusieurs résistants qui se trouvaient là. Vers 4 heures, chez Mme Clerc, café Jeannot à Bourg-de-Péage, elle réussissait à se rendre compte de la présence de plusieurs maquisards.
Le lundi 31 Juillet elle commença d’opérer. La veille au soir, son complice, l’ignoble Saraillon était passé chez plusieurs de ses anciens camarades pour les prévenir que leur chef, le Capitaine Abel, reformait un maquis vers Die et viendrait les prendre le lendemain vers 9 heures. Ce furent les Allemands, guidés par Saraillon qui vinrent. Par bonheur, plusieurs dissidents alertés par M. Clairfond, de Bourg-de-Péage, qu’une maladresse de Saraillon avait mis en éveil, purent s’enfuir. Mais deux malheureux jeunes gens : Knapp et Lieb furent arrêtés et par la suite exécutés. Ne trouvant personne à la boucherie Bard, ils pillèrent et cassèrent tout le mobilier. Vers 18 heures ce fut l’arrestation de Mme Clerc qui fut transférée à St-Nazaire. Mme Clerc put particulièrement se rendre compte de l’influence extraordinaire qu’exerçait Mireille Provence sur Oberland. Citons textuellement ses paroles : « N’oublions pas que c’était elle, Mireille Provence, qui, à St-Nazaire, commandait tout ; le commandant Oberland était un jouet entre les mains de cette femme.»
Le mardi avait lieu le pillage de l’épicerie Satre et le vendredi 4 Août l’arrestation du Lieutenant Satre, de M. André Chaloin, l’incendie de la ferme Chaloin et le pillage des domiciles du Capitaine Vincent, du Lieutenant Vergnon et de l’Adjudant Olivier. Elle pouvait, ainsi que son acolyte, regagner St-Nazaire et y reprendre sa tâche de dénonciatrice. Deux nouveaux morts jalonnaient sa route, elle espérait bien trois, mais la libération devait sauver la vie au Lieutenant Satre.
D’autre part, le 26 Juillet 1944, un camion chargé de 19 prisonniers quittait St-Nazaire pour Grenoble. Arrivé au pont de Beauvoir, il rencontra des voitures de miliciens qui arrêtèrent le camion, se firent remettre les prisonniers par les Allemands et les tuèrent lâchement dans le petit vallon, à une centaine de mètres de la route. Cinq gendarmes faisaient partie des victimes. L’identité des assassins ne put être établie. On peut toutefois signaler la présence d’une femme parmi ceux-ci. Une enquête sommaire a en effet confirmé qu’une femme faisait bien partie de la bande. M. Veyret André, Mme Roux, Mme Kasnicki et le jeune Paul Fusier, tous de St-Romans l’ont vue alors qu’elle descendait de la voiture des miliciens ; ils ont pu donner un signalement assez précis : grande, belle femme, cheveux blonds assez longs, vêtue d’un pantalon-fuseau bleu marine et d’un corsage blanc. Tous ceux qui ont connu Mireille Provence, soit à St-Nazaire, soit à Romans ou Bourg-de-Péage sont d’accord sur ce signalement. D’ailleurs, le témoignage du jeune Raillon, de St-Vincent-de-Charpey prouve que Mireille Provence était à St-Nazaire le 26 Juillet. Capturé le 25 au soir, à 21 heures, par un groupe d’Allemands, il a été interrogé le 26 juillet par le Commandant Oberland assisté de Mireille Provence. Il a été ensuite séparé de ses camarades de captivité (dont quatre gendarmes) qui ont été emmenés dans une chambre du deuxième étage de l’école de St-Nazaire. Une voiture de miliciens se trouvait dans la cour. Vers 14 heures, les condamnés descendirent. Peu après le camion s’ébranlait : les malheureux partaient vers Beauvoir.
Le jeune Raillou n’a pas revu Mireille Provence jusqu’au lendemain matin. Il ressort de ce témoignage que c’étaient des condamnés à mort qui partaient pour Beauvoir et non des prisonniers dirigés sur Grenoble. Le fait d’avoir séparé ceux contre qui rien n’avait pu être prouvé le montre. D’autre part, il est reconnu que les prisonniers enfermés au deuxième étage de l’école de St-Nazaire étaient destinés à être fusillés. Comment Mireille Provence au courant de tout ce qui se passait à St-Nazaire aurait pu ignorer la tragédie qui se préparait ? On peut aisément penser qu’elle en fut l’instigatrice et qu’elle y prit part personnellement.
A la libération de notre région si cruellement atteinte, le bruit de la mort de Mireille Provence se répandit rapidement dans Romans-Bourg-de-Péage. Un corps de femme criblé de balles avait été retrouvé à Eymeux au lieu dit le Pont et un maquisard de passage avait reconnu une bague-chevalière qui se trouvait au doigt du cadavre comme appartenant à Mireille Provence. Tout le monde fut persuadé que justice avait été faite et nul ne s’inquiéta plus dans nos deux villes. Mais, coup de théâtre, Mireille Provence est arrêtée et l’on se demande si voyant les affaires de l’Allemagne et donc aussi les siennes se gâter, Mireille Provence n’avait pas songé à disparaître en faisant assassiner une femme au doigt de laquelle elle avait glissé sa chevalière ?
Maintenant elle attend son jugement, son dossier est instruit par le tribunal de Grenoble.
Les croix blanches du petit cimetière du château de St-Nazaire accusent.
**
15 AOUT
(Mon journal)
A 11 h. 50, un coup de téléphone m’informe qu’une radio étrangère vient d’annoncer le débarquement en Méditerranée. La nouvelle est confirmée à 12 h. 30 par la radio anglaise. C’est l’enthousiasme. A 13 heures, des vagues de bombardiers survolent la ville et nous nous extasions à la fenêtre… Une minute après : 13 h. 01 exactement, les bombes tombent sur Valence. L’alerte sonne. Nous regagnons les abris. Deux nouvelles alertes dans l’après-midi. Nos équipes d’urgence et de D. P. et nos pompiers sont appelés à Valence où 100 bombes de 250 kgs ont été lâchées pendant sept minutes sur la ville. La préfecture et tout le quartier sont en feu. L’hôpital est détruit. Le soir, nouvelle alerte, de 23 h. 20 à minuit 5. Toute la population est dans les abris. L’aviation alliée attaque le camp d’aviation de la Trésorerie. Le ciel est en feu. Cinq bombes tombent sur la Maladière. Il y a un mort et trois blessés.
Ceux de la D. P. sont perchés sur la terrasse de la maison Molinari. C’est vraiment féerique, tragiquement féerique. Les fusées éclairantes créent un jour artificiel, cru, brutal, qui donne aux moindres choses lointaines ou rapprochées un relief curieux. Du ciel tombent les papiers argentés dont les aviateurs se servent pour dérouter le repérage au son. Le terrain des Chasses est subitement éclairé par une fusée emportée par le vent. Vont ils lancer des bombes ici, et les chefs de secteur recommandent à tous d’être prudents.
On rejoint son poste. Tout d’un coup, près du passage à niveau des Trois Croix, un sifflement prolongé, une étoile filante verte. A peine aplati au sol, c’est l’explosion terrible. Une bombe était tombée sur la voie ferrée, très bien placée par un avion en piqué.
**
LES 20 MILLIONS DE LA BANQUE DE FRANCE
(Mon journal)
Le 16 août au matin, deux dissidents se présentent au Directeur de la Banque de France : « nous ne recevons plus de subsides de Londres, la Libération approche, nous avons un besoin immédiat d’argent. »
Le Directeur, M. Redinier, évacué de Sarreguemines (Moselle), en septembre 1939, expulsé de Metz, en septembre 1940, haït les Allemands, mais il est dans l’obligation d’observer les mesures de sécurité prescrites en cas d’attaque. Il le fera, mais en y apportant la manière.
Le 16 août, à 13 h. 30, quatre hommes se présentent à la Banque : l’un tient en respect le concierge, l’autre la famille du Directeur et les deux derniers pénètrent dans le bureau de M. Rédinier, exigeant sur le champ 30 millions. Ils ne présentent aucun bon de réquisition, ils n’ont respecté aucune consigne… Rien ne ressemble à l’opération annoncée.
Et c’est pourquoi un incident malheureux et regrettable se produit : en raison d’un manque de coordination entre les chefs du groupe agissant ce jour-là, ignorant les consignes données la veille, l’opération est prématurée et la police est alertée.
Le grand malheur, c’est qu’un des assaillants, un bon petit gars, un ardent patriote est tué net près de la loge du concierge. Aussitôt ses camarades affolés tirent quelques coups de revolver de l’intérieur, sans toucher personne sur la place où le vide s’est rapidement fait. Ils regagnent les appartements du Directeur et s’enfuient vers les jardins. Quelques instants après les Pompes funèbres relèvent le corps d’un malheureux garçon tué en service commandé, victime d’un contretemps regrettable.
Jeudi 17 août, à 9 heures, une camionnette s’arrête devant la Banque de France et quatre jeunes gens armés pénètrent dans l’établissement. Tous les clients sont introduits dans le bureau du Directeur. Un bon de réquisition de 20 millions est présenté à ce dernier et nos hommes descendent dans les coffres pour rassembler le précieux magot !…
Pendant l’opération, les bruits d’une rafale de mitraillette tirée sur la place arrivent jusqu’à eux. Nos dissidents s’affolent. En effet, un allemand en patrouille, inquiété par la présence de la camionnette, a soulevé une couverture à l’intérieur de celle-ci et a constaté la présence d’armes automatiques et de grenades. Il a aussitôt tiré une rafale de mitraillette pour alerter ses camarades. La banque est cernée, des renforts demandés, toute la place gardée.
A l’intérieur nos jeunes ont pris la fuite (sans emporter les 20 millions) par l’appartement du Directeur et les jardins de la Banque. Ils se réfugient quelques heures dans le clos des Sœurs de Bon Secours, où ils dissimulent leurs armes.
A la Banque les boches fouillent les clients, interrogent le Directeur, lequel est durement malmené pour n’avoir pas fait usage de son revolver contre ces « terroristes ». Les Allemands visitent l’établissement, mais visiblement inquiets ils ne pénètrent pas dans le sous-sol. Ils arrêtent le dissident Sauvageon, dit Ludo, qui en short leur paraît suspect.
Ludo est conduit à la caserne, interrogé. Il passe la nuit en prison. Tard dans la soirée, un boche est venu lui dire qu’il sera fusillé le lendemain à 6 heures, mais…. le lendemain on le conduit à Valence. Le camion s’arrête à l’entrée de la ville et il doit traverser toute l’agglomération valentinoise les bras en l’air, pour aboutir à l’Hôtel de Lyon, siège de la Gestapo. Il est interrogé et alors qu’il se trouve dans le hall et qu’il va être conduit à la cave, les bombardiers anglais arrivent juste à point. C’est l’heure où le pont est bombardé. Les allemands se couchent à terre. Les secousses du bombardement font tomber les panneaux de bois qui bouchent la vitrine de l’Hôtel de Lyon, et, Ludo qui préfère mourir sous les bombes que sous les coups des nazis tente une évasion qui fort heureusement pour lui réussit….
Mardi 22 août, une heure avant la prise de Romans, le Directeur de la Banque de France remettait à la dissidence les 20 millions qu’il avait été si difficile de « piquer ».
**
20 AOUT
(Mon journal)
A 9 heures, alerte. L’aviation bombarde Châteauneuf. Cinq alertes de jours. Des voitures dissidentes, tous drapeaux déployés, tentent quelques imprudentes incursions dans la cité.
**
21 AOUT
Ce lundi soir, les allemands tirent des coups de feu sur la place Jules-Nadi. Ils sont à la poursuite d’une voiture Vacher qui leur enlève des munitions. Au lieu de transporter les caissettes à la gare, un dissident, habillé en Allemand, monte sur le siège, et la voiture prend une autre direction.
A 20 heures, l’aviation américaine pilonne les convois allemands sur la route de Valence. Un avion allemand poursuivi rase les maisons. L’alerte sonne. Nous restons une heure dans les abris.
On affirme que les américains sont à Crest. Nous ne voulons pas y croire.
*****************************
22 AOUT !… et les jours de liberté qui suivirent
MARDI 22 AOUT
(Mon journal)
Romans a été libéré par ceux qui, depuis longtemps, vivaient dans le maquis en attendant patiemment l’heure H.
Cette heure est venue… Hélas, la tragédie du Vercors a privé certains de cette joie immense de vivre ce jour. Mais leur sacrifice n’a pas été vain. Il a préparé cette victoire des forces du maquis, des soldats de la résistance, admirables entre tous, qui ont permis de libérer une grande partie de la France et ont apporté ainsi à nos Alliés une aide inestimable.
Roger Raoux, dit Morgan, responsable de Romans avait pris contact le 21 avec les éléments avancés des divisions américaines arrivées à Crest. Il se présentait au Colonel, lequel déployait une carte, mesurait les distances et déclarait que les éléments allemands de Romans seraient réduits le lendemain par l’artillerie et l’aviation américaines.
Morgan ne voulait pas, il ne pouvait pas accepter que la population romanaise souffre et que la ville risque d’être rasée pour anéantir la petite garnison boche.
Il donnait donc, de sa seule autorité, l’assurance que le lendemain les F. F. I. seraient maîtres de la ville de Romans.
Vers 8 heures, M. Cuminal qu’on n’avait pas revu depuis le 9 Juin avait annoncé la nouvelle à la gendarmerie, à la police et à la mairie où il faisait évacuer les femmes des différents services.
C’est le chef d’escadron Thivolet, qui se donnait depuis quatre ans à la Dissidence, et le Commandant Modo, officier parachuté, qui ont commandé l’attaque de la garnison de Romans.
Mardi, à 9 heures 30, leurs hommes, appuyés par de nombreux éléments romanais, F. F. I., F. T. P., A. S., se portèrent d’abord vers la gare où les allemands gardaient un train de munitions et les occupants s’enfuirent vite vers la caserne sous les balles d’armes automatiques. Ce fut ensuite l’attaque du garage Citroën, des groupes disséminés en ville, puis le gros coup : l’immense bâtiment de la caserne. Les Français cernèrent les bâtiments et, des toits voisins lancèrent à toute volée des grenades sur les ennemis. Des grenades « Gamon » continuant à pleuvoir, les incendies gagnèrent rapidement les bâtiments et les Allemands tentèrent une sortie en camions précédés d’une auto blindée. Ils firent 2 à 300 mètres en direction de la route de Tain, mais ils furent immédiatement assaillis par les Français qui les prirent sous le feu de leurs F. M. et arrêtèrent les camions, tuant une trentaine d’Allemands et faisant les autres prisonniers. Dans le même temps, les Allemands cantonnant dans le Collège mettaient en batterie un canon anti-chars dans l’arcade de la porte principale, tandis que plusieurs petits canons étaient camouflés dans les massifs adjacents. Au moment où ces diverses pièces ouvraient le feu, des éléments du 11e Cuirassiers ripostèrent avec leurs armes automatiques, et réduisirent au silence ce redoutable guêpier.
Après cet enfer, ce fut le délire, l’élan de reconnaissance envers les libérateurs, la pensée pieuse pour les morts.
**
VU DE LA PLACE JULES-NADI
(Mon journal)
Au marché, les ménagères se pressent ; une certaine inquiétude règne. A la boulangerie chacun dit son mot. Les personnes qui habitent au-delà des passages à niveau affirment que les dissidents qui se préparent ne leur ont donné que quelques minutes pour faire les courses indispensables, car l’attaque des positions allemandes est imminente. Dans une atmosphère de nervosité chacun se presse. A 9 h. 30, on peut percevoir, venant de la gare, les premiers coups de feu. Les dissidents attaquent les boches occupés à charger un train de munitions. Chacun regagne sa maison. Les fenêtres et les portes se ferment, et la ville est aux combattants. Dans tous les coins les fusils-mitrailleurs s’installent. La bataille fait rage à la gare, chez Citroën, à l’Hôtel-de-Ville, au Collège, à la Caserne. Nous restons un peu dans la cave, puis nous risquons quelques sorties, mais dans le jardin les balles sifflent sur nos têtes. De violentes explosions provenant des casernes ébranlent la maison. Vers 12 h. 30 nous regagnons l’appartement ou plus exactement la cuisine où nous sommes à l’abri en raison des murs épais. Pendant le repas le combat augmente d’intensité. On s’entend à peine dans la pièce bien fermée. A travers les volets on voit sur la place nos petits gars postés avec leur fusil-mitrailleur au coin de chez Sauvan, dans les escaliers de la rue de la Banque. Un motocycliste allemand débouche de la côte des Cordeliers : Tous les feux se concentrent sur lui. Il gît dans une mare de sang au côté de sa moto… devant le hall du Petit Dauphinois. Mme Gosse, qui habite l’appartement au-dessus de la banque Bernard est sérieusement blessée. Nos vitres du premier étage sont brisées. Les meubles reçoivent des éclats. A 13 h. 11, le bâtiment de la caserne Bon, transformé par les Allemands en poudrière, saute.
En l’espace de quelques secondes c’est le délire. Tout Romans est dans la rue. On donne à boire, à manger à nos vaillants combattants. On applaudit les Sénégalais qui ont participé brillamment à l’assaut de la caserne, et des voitures portant l’inscription F. F. I. (Forces Françaises de l’Intérieur) arrivent de toute part. L’état-major Thivollet s’installe à l’Hôtel-de-Ville. Notre Commissaire de retour de ses vacances sort du Commissariat ceint d’une écharpe tricolore… et nous retrouvons des visages familiers de maquisards.
Parmi eux, la mitraillette à l’épaule, entre deux F. F. I., un personnage qui depuis plusieurs mois nous paraissait suspect se dirige vers le commissariat. C’est le masseur Gérard Morgan. Il est accusé d’avoir tiré sur les français. Il va être jugé par le Commandant Thivollet. Nos appréhensions à son sujet ne nous avaient pas trompés. Le Docteur Barlatier, maire, est emmené dans sa propriété en résidence surveillée. Un administrateur est nommé. Il s’agit d’un sympathique maquisard du Vercors, M. Roger Raoux, dont le nom de guerre est : Roger Morgan. Dans la soirée l’affiche suivante est apposée en ville, alors qu’à toutes les fenêtres à tous les édifices les drapeaux sont largement déployés.
République Française – Liberté. Egalité. Fraternité.
APPEL A LA POPULATION
L’heure de la Libération est venue.
Aidées et soutenues par l’avance foudroyante des troupes alliées nos forces ont libéré notre ville de l’envahisseur.
La Liberté reprend ses droits dans le Dauphiné d’où elle était partie à la conquête du monde.
Sachez vous en montrer dignes.
Conservez le calme et le sang-froid qui vous ont valu l’admiration du monde pendant les années douloureuses que vous venez de vivre.
Nos épreuves ne sont pas terminées. La guerre est encore à nos portes.
Nous mettrons tout en œuvre pour adoucir vos souffrances et vos privations, mais nous exigeons de vous la stricte discipline que nous imposent encore les événements.
Chacun doit rester à son poste ou à sa place.
Nous ne tolérerons aucune vengeance personnelle.
Nous punirons de mort tout acte de pillage.
Les traîtres seront châtiés ; les coupables, quels qu’ils soient seront punis, mais dans la plus stricte légalité.
L’arbitraire a fini son temps. La vraie France renaît !
Vive la France !
Vive la République !
L’Administrateur : R. Morgan.
Dans un bruit épouvantable de moteurs et dans une atmosphère d’intense nervosité, le soir, le magasin du milicien Cottavoz est saccagé. Grenades dans les vitres, coups de feu, etc.. Le minotier Ferrier, père du milicien Ferrier, est tué au cours de cette nuit à la fenêtre de son habitation.
Le ciel s’illumine de toutes parts ; détonations, explosions nous tiennent en éveil.
Et puis… nous sommes libérés, bien sûr… mais tout seuls. Les Américains ne sont pas encore là. Notre garnison allemande a été maîtrisée, mais le Boche est à Tain, à Châteauneuf, à St-Marcel…
L’inquiétude tempère la joie.
**
AUTOUR DU P. C. THIVOLLET
(Extrait du journal du Lieutenant Lagier)
22 Août. – Le P. C. du Commandant Thivollet est installé dans le jardin de la clinique Brunet. Aux côtés de Thivollet et du Capitaine Modo, le Commandant Phiphi attend ses troupes F. T. P.
Les hommes des différents pelotons arrivent au passage à niveau de la route de Mours. On les divise en deux groupes. L’un passe par la rue Jacquemart avec pour objectif la caserne, l’autre essaie d’atteindre le Boulevard de l’Ouest, objectif : Garage Citroën.
Ce deuxième groupe comprend des sénégalais commandés par le Capitaine Moine. Le jeune Maurice Bernard et M. Boiron les accompagnent.
Ce groupe essuie des coups de feu provenant vraisemblablement d’une fenêtre de l’Hôtel Parisien (des chambres y étaient réquisitionnées par les Allemands) et des wagons de la P. V.
Quelques tirailleurs peuvent s’engager sur le boulevard de l’Ouest. Les autres, ainsi que Boiron, se réfugient dans la cour de l’immeuble de Mme Maillet et essayent de neutraliser la défense des Boches. Le premier tirailleur San-Badour est blessé devant le portail du Garage de la Compagnie de la Drôme. Il se replie et vient tomber devant le café Tarin où il est soigné par ma sœur, avant d’être évacué sur la clinique Brunet.
A 10 heures, je me présente au P. C. Thivollet. Je dois assurer d’abord une liaison de renseignement jusqu’au Relais des Alpes, par la rue de Delay, l’avenue Emile Zola. La rue Parmentier étant bombardée par un mortier se trouvant dans la cour de la caserne, je prends le chemin rural n° 2. Aux Trois-Croix, je trouve Bastide, auquel je demande d’informer les combattants de la Compagnie Bourgeois d’économiser les munitions et d’essayer d’approcher du Collège, en passant par l’avenue des Alpes et le Boulevard Voltaire.
Retour de liaison à 11 heures. Le P. C. Thivollet est alors installé dans l’appartement de M. Ferrieux. Le Commandant Phiphi me charge de contacter ses troupes qui vont arriver de St-Donat par le passage à niveau de La Martinette. Je gagne ce passage à niveau en empruntant le chemin du Mât Bâtie pour aboutir rue Jeanne-d’Arc où je place M. Nathanson en sentinelle pour prévenir les groupes F. T. P.
Bientôt, autour du P. C, on voit arriver les premiers prisonniers. Les blessés doivent être mis à l’abri. Mlle Bonnet et ma sœur, aidées de quelques dames de la Croix Rouge, organisent un poste de secours au garage Deroux et Robin. Les prisonniers, rassemblés dans l’immeuble Couchât, sont fouillés et interrogés par un homme qui parle couramment l’allemand et qui s’est introduit dans le garage, on ne sait comment. J’apprendrai le lendemain que c’était un traître ; il a été fusillé sur la place Jacquemart.
Un peu plus tard les troupes F. T. P. traversaient la ville pour aller courageusement prendre contact avec les allemands aux portes de Valence.
**
AU GARAGE TABARIN
(Journal Malmuth)
Vers 9 heures, coup d’œil au garage Tabarin pour se rendre compte de la situation. Les Allemands sont au travail ; un grand nombre de véhicules encombrent le boulevard de l’Ouest ; les sentinelles gardent les passages dans les barbelés.
9 heures 30. Nous remontons vers Génissieux pour prendre possession des armes. Les Allemands se doutent-ils de quelque chose ? Toujours est-il que du bâtiment central de la caserne s’élève déjà une épaisse fumée. A la sortie de Romans, le camion chargé d’armement arrive. On s’équipe en hâte ; des paysans nous donnent un coup de main ; les groupes sont constitués. En route !
Coupant à travers champs nous rejoignons l’avenue Thiers par laquelle descendent déjà des camions chargés d’hommes. Des Sénégalais arrivent de Peyrins portant, comme autant de colliers fétiches, leurs cartouchières et des bandes; de mitrailleuses. Et les drapeaux tricolores entrent dans Romans.
Nous descendons jusqu’au passage à niveau de la route de Mours où nous prenons position, pour peu de temps d’ailleurs, car bientôt l’ordre arrive de gagner la rue Turpin. Nous longeons la voie de chemin de fer jusqu’à l’Ecole Pratique. Par dessus le mur on passe F. M. et mitrailleuses et nous voilà dans la cour extérieure de l’école. Entre une petite halte – le soleil tape dur – un rafraîchissement nous est servi par le directeur…. et ma foi, c’est le bienvenu. Puis, traversant la rue Bouvet nous gagnons la rue de l’Ouest. De l’autre côté du boulevard, des Sénégalais sont en position. La bataille est déjà déclenchée et on voit les rafales ennemies ricocher sur les murs.
Dans la rue Turpin, nous ne sommes pas encore exposés, les Allemands s’étant retranchés uniquement autour du bâtiment sud du garage Tabarin. Un groupe avancé arrive à la hauteur de la rue (actuellement, rue Lieutenant Grimaud). Les Allemands sont à 60 mètres, à l’autre extrémité. Un camarade veut traverser afin d’avancer par l’avenue Duchesne. A peine a-t-il pris son élan qu’il s’écroule. Impossible de lui porter secours, les balles sifflent continuellement. Alors un F. M. se place courageusement au milieu de la rue et déchargeant chargeur sur chargeur surprend les Allemands qui s’arrêtent de tirer, pendant que deux camarades vont chercher celui qui est étendu tout près. Une infirmière donne les premiers soins. Un brancard emmène le blessé.
Une farouche résolution nous fait serrer plus fort la crosse du fusil. A notre tour d’avancer. Notre groupe composé d’un lieutenant, d’un tireur F. M., d’un approvisionneur va se placer dans un hangar, le F. M. tirant par une ouverture dans le portail. En hâte des sacs de chaux sont amenés pour constituer un semblant d’abri. Des équipes consolident l’ensemble. La bataille fait rage. On reconnaît le bruit de nos mitrailleuses qui crachent leur feu dans trois directions. A plusieurs reprises l’explosion sourde d’une grenade nous donne de l’espoir. Bientôt au bruit de la mitraille se mêlent des ordres, des coups de sifflet, puis le lieutenant, sans un mot – les balles sifflent encore de l’autre côté du portail – dégage l’ouverture, s’élance avec son seul pistolet à la main. Nous le suivons et prenons place derrière un camion, à dix mètres des Allemands qui se sont réfugiés à l’intérieur du garage.
De tous côtés, les groupes arrivent maintenant par la rue Paul Bert, et le nord du boulevard de l’Ouest. Le garage est cerné. Mais le Boche ne s’est pas encore rendu. Des toits avoisinants les tireurs et les grenadiers nous font signe. Les « Gamons » qu’ils ont lancées ont fait leur effet. Le Boche est retranché dans un coin du garage. Nos rafales ne peuvent l’atteindre.
Les fenêtres du premier étage cachent peut-être quelque chose. Une rafale bien dirigée nous tranquillise. Rien ne répond. La petite porte qui donne accès aux appartements ainsi qu’au garage (dans la rue Paul Bert) attire notre attention. Nous nous avançons jusqu’à quatre ou cinq mètres. Nous tirons. Peu après le loquet tourne. Les nerfs tendus nous avançons, le doigt sur la gâchette. La porte s’entrebâille, un casque roule au milieu de la rue, puis une cartouchière et un Allemand, tout tremblant, les yeux exorbités sort et se plaque contre le mur, « pas kapout » ? Les mots que nous attendions depuis longtemps, enfin ils les prononcent, vaincus. Nous ne tirons pas. Le matin, cependant, nous étions bien décidés : « Pas de prisonniers, on les descend tous ! » Mais le coœur des Français a eu le dessus, nous n’avons pas tiré sur ces loques désarmées ; nous ne sommes pas des Boches !
Un à un ils sortent tous, quatorze. Ils sont maintenant alignés, les bras en l’air, à l’endroit où quelques heures auparavant ils étaient encore si menaçants. Et toute la population du quartier, massée derrière les barbelés pour assister à la fin de la lutte, envahit en un instant tout le boulevard.
Tout le monde est content, peu de cris cependant. Pas de chant, non ! des nôtres y sont restés à cause de ces feldgraus qui maintenant ne savent où poser leur regard ; et puis la lutte n’est pas finie. Un groupe emmène les prisonniers du côté de Mours. Nous procédons au nettoyage de l’école Gaillard et des maisons environnantes. Rien ! le Boche a peur ; il préfère se rendre. Puis les groupes reprennent leur formation et nous nous dirigeons vers la place d’Armes où la bataille bat son plein.
**
VU PAR DANIEL
L’attaque contre Romans se déclenche sans que nous en soyons avertis. Malgré cela les hommes se retrouvent au camion de munitions où la distribution sera faite par Jansen. Ils partiront par groupe à la bagarre. La compagnie sera représentée partout où il y a des boches, à la gare, au garage Citroën (où le grand Mazeyrat monté sur le toit d’une maison lance une Gamon sur le garage ; l’explosion le projette du toit sur un camion bâché et de là à terre où il se retrouve sans mal) ; elle sera aussi à la caserne Bon où le groupe tirera tous ses projectiles, rue Palestre, au boulevard Gambetta.
Nous sommes chez Chartier, le toubib et moi. A 9 heures 30, on entend tirailler un peu de partout. Nous attendons pour partir que la route de Génissieux soit libre. A 9 heures 45, nous partons. Chartier nous accompagne jusqu’au passage à niveau. Au coin de la rue Victor-Hugo, un camion est arrêté, criblé de balles, le réservoir crevé, le mazout coule sur la route. A côté d’une grille un boche est allongé, la tête à moitié emportée. Nous fonçons en direction du camion. Nous arrivons juste à temps pour emmener la section sur le boulevard Gambetta.
Au passage à niveau des Trois Croix nous rencontrons l’escadron Bourgeois. Nous nous partageons le travail. Nous tiendrons le secteur partout, du P.L.M. jusqu’au boulevard Gambetta inclus. Lui placera ses hommes du boulevard à l’Isère, de manière à empêcher une sortie de l’ennemi par les jardins et nous donnera un groupe de mitrailleurs en renfort au boulevard.
M. Torrent, de la Cité Jules-Nadi nous guide dans les rues, derrière l’usine Fénestrier et nous indique toutes les positions des boches. C’est lui qui fera le ravitaillement en vin au mépris du danger. Pour garder le boulevard nous disposons d’une mitrailleuse et d’un fusil-mitrailleur, bien approvisionnés par les soins de Jansen.
A la mise en place des armes nous apercevons des boches qui font la navette du collège à la caserne Bon. Ils ne se doutent de rien et stationnent sur le boulevard. Nous attendons d’en voir une vingtaine pour ouvrir le feu. La riposte ne se fait pas attendre. Mais ils tirent haut, les balles sifflent dans les platanes, les feuilles tombent comme en automne.
Nous n’avons aucune liaison avec les combattants du centre de la ville. Je suis un peu inquiet. Nous n’avons pas de directive et nous conduisons l’assaut par initiative personnelle. Je profite d’un moment de calme pour partir avec le toubib voir les groupes.
Nous remarquons des jeunes gens et des hommes qui ne montrent que le bout de leur nez par les portes entrebâillées. Pendant que nos hommes se battent et risquent leur vie, eux, restent bien à l’abri, quittes à crier plus fort que les combattants si nous remportons la victoire, ou à nous désavouer en cas d’insuccès quand tout danger sera passé.
Nous revenons au boulevard au moment où saute le dépôt de munitions de la caserne Bon. Il est 13 h. 15. La mitrailleuse est enrayée. Le tireur s’active pour la réparer à l’abri dans la rue Amiral Courbet. Il ne reste sur le boulevard que le F. M. en batterie.
Je remplace le tireur pendant qu’il va manger et je m’installe. Depuis le matin j’avais une envie folle de faire un carton avec le F. M., aussi je ne m’en prive pas.
Nous ne restons plus que trois sur le boulevard : le chargeur, un guetteur et moi. Le restant des hommes est dans la rue Amiral Courbet où ils se préparent à faire un bond en direction du collège.
Vers 13 h. 30, le guetteur me signale du remue-ménage en face de la caserne Bon et brutalement c’est l’alerte. Un convoi se dirige sur nous. Les boches tentent une sortie.
Je tire sur la première voiture. Il ne me reste que quatre balles dans le chargeur et je manque la cible. Le temps de se relever, de changer de chargeur, la voiture arrive à ma hauteur. C’est une Simca. Je tire, mais trop haut (je fais du tir instinctif, sans viser. (Le F. M. pèse 14 kgs et c’est la première fois). La deuxième voiture arrive ; c’est une Peugeot. Je tire à nouveau. La voiture fait une embardée, mais continue. Elle n’ira pas loin et sera arrêtée par un groupe après la cité. Elle était conduite par un capitaine ; il a une balle dans le coude.
Je jette un coup d’œil en arrière. Je vois une traction avant qui arrive à toute vitesse. Cette fois je prends mon temps. Je me cale contre un arbre et j’attends. La voiture passe. Les occupants qui ont repéré le F. M. tirent en arrivant à ma hauteur et me ratent. A mon tour, je tire. Cette fois je l’ai eue. La voiture va percuter contre un poteau télégraphique. Nous y retrouvons un capitaine mort et deux blessés. Pendant ces quelques minutes les hommes qui se trouvent dans la rue Amiral Courbet ont tiré sur les deux premières voitures dans le virage. Ma position ne leur permet pas de commencer le feu avant.
Deux minutes se passent. J’ai eu le temps de reprendre la position couchée qui est tout de même plus commode. Une quatrième voiture vient. A la première rafale, elle se met en travers de la route. Une cinquième qui suivait, double. Elle subit le même sort. Ce sera la fin. Une seule voiture, la Simca, a passé. Elle sera arrêtée à Saint-Marcellin.
La section avance en direction du collège sous le couvert des arbres. Nous n’avons pas fait 150 mètres que nous apercevons un boche qui agite un drapeau blanc, en l’occurrence, une serviette de toilette. Nous continuons notre marche en nous méfiant malgré tout. Nous ramassons une quinzaine de prisonniers et faisons la jonction en face du collège avec les camarades.
La victoire est à nous.
Nous sommes sales et en sueur, mais la joie rayonne sur tous les visages. Romans est libre et nous n’avons eu qu’un blessé : le jeune Chapus, atteint alors qu’avec son fusil-mitrailleur il tire contre les camions boches qui tentent une sortie sur le boulevard. La compagnie se regroupe en face du café Fayet. Nous avons vraiment l’air de terroristes. Les gens nous regardent comme des bêtes curieuses. Ils pensent voir comment sont faits les fameux maquisards dont tout le monde parle, mais que peu connaissent.
Nous aurons une nuit de repos. Le lendemain la compagnie prend position à la Maladière. Nous laissons les habitants à leur joie et nous regardons du côté de Valence avec inquiétude. Nous savons qu’il est plus facile de perdre que de conserver. Ce sera d’ailleurs difficile avec les moyens dont nous disposons.
Les renseignements reçus précisent que les restes de la 19e armée allemande montent le long de la Vallée du Rhône venant de Bordeaux et de la Méditerranée. Un seul espoir nous reste. Les Américains sont là. Que vont-ils faire ?
**
VU DE L’HOPITAL ANNEXE DE LA RUE GUIBERT
(Journal Ch. Chaze)
A 9 heures 30, la sirène d’alertes retentit et de 9 h. 30 à 19 heures il faut, par ordre, demeurer au poste téléphonique où affluent de toutes parts les demandes de brancards et de docteurs.
Notamment deux grands blessés sont amenés au poste de Notre-Dame de Lourdes. Deux grands blessés aussi à la cité où un chef allemand meurt dans le poste.
Deux F.F.I. blessés sont amenés chez nous. Pansements rapides par le docteur à la lueur de la lampe électrique, l’électricité s’étant éteinte après des fracas effroyables au-dessus de nous. Un troisième blessé n’est pas descendu au fond de l’abri : il doit être emmené d’urgence à l’hôpital : c’est un courageux agent, Marcel Gaudry, qui vient d’être atteint au ventre. Les camarades l’entourent, bouleversés; ce sont des « au revoir » rapides ; son chef lui dit avec émotion : « Courage, mon petit, on va te retaper ». Mais le brancard parti on se regarde, le cœur serré d’une lourde angoisse. Cet « au revoir » n’est-il pas un adieu ?
…Marcel Gaudry, ce jeune agent lorrain, repose au cimetière de Romans en compagnie de beaucoup de nos frères, parents et amis.
Le soir à 20 heures, installation, 6, rue Guibert de douze premiers blessés des bombardements de Saint-Vallier et Romans.
Quelques instants après leur poignante arrivée, horrible tuerie devant la maison même. Une motocyclette allemande arrive en trombe de la direction de Tain et après avoir, à 100 à l’heure franchi plusieurs barrages F.F.I., des coups de feu venant de la direction de la rue Pêcherie que les allemands allaient prendre, détériorent la moto lancée qui fait une terrible embardée, happant au passage un paisible promeneur, notre voisin, le sympathique coiffeur Antoine Mouradian. Couché sur le dos, il fait quelques efforts pour se soulever, retombe et une balle tirée par l’officier allemand motocycliste qui se dresse auprès de la machine gisante, l’immobilise pour toujours. Sa femme qui raccompagne et que l’angle d’une maison avancée nous cache, est tombée évanouie. L’officier allemand se penche sur son camarade vidé du tam-sead et allongé en travers de la rue, mourant. Il lui soulève le bras, le laisse lentement retomber et se dresse alors, les yeux terribles, cherchant l’origine des coups. A ses pieds la moto perd huile et essence. Alors il brandit son revolver et à grands pas marche dans la direction des coups en tirant sans arrêt. Il se dirige vers la mort…
Là, nous le perdons de vue. Nous apprenons peu après, par des témoins directs que, sous les coups de feu il est monté, tirant toujours, jusqu’au pied de la petite fontaine, côte des Poids des farines. Puis, ayant épuisé ses munitions, il jette ses revolvers et lève les mains, mais les coups de feu n’ont pas cessé et lui ont transpercé le corps. Il a été emmené sur le champ en travers d’une voiture, sur le capot.
Et le drame continue, rue Guibert. Deux jeunes dissidents déchargent leurs armes sur l’allemand du tam-sead. Etait-il mort ou seulement mourant ? nul ne le sait. Pendant ce temps les brancardiers de l’hôpital emportent le corps du pauvre Antoine. Mais les deux jeunes gens ont été rapidement rejoints par un groupe de cinq à six camarades pleins d’ardeur. Ils s’emparent des armes de l’allemand tué et, sachant mal les manier, s’entre-tuent… sans le vouloir. L’un d’eux reçoit un coup de mitraillette en pleine poitrine : il est à demi-nu, sans chemise. Nous voyons l’horrible entrée des balles et l’apparition d’un sang noir abondant. Il est tué sur le coup. L’autre reçoit une grave blessure à la cuisse par le même coup. Si nous ne nous trompons pas, ce pauvre garçon est mort à l’hôpital. Pendant un moment les brancards ne cessent de circuler et la rue est lamentablement marquée de traînées de sang. Les cœurs sont très tristes… Les drames successifs, si affreux ont obscurci la joie de la libération…
**
VU DES TROIS-CROIX
(Journal R. Bastide)
A 10 heures, prise de Romans… et ce n’est pas un bobard cette fois-ci. L’ordre est précis : Que chacun rentre chez soi. Il vient de m’être confirmé et je sais ce qui m’est dévolu comme rôle : faire rentrer les gens.
La rue Saint-Nicolas est encore trop animée. « Fermez donc votre magasin », crie-t-on. Un sourire incrédule du boutiquier contient je ne sais quoi d’apitoiement et d’indulgence. « La barbe avec vos bobards ».
Un groupe de gens passe. Vais-je avoir encore un sourire incrédule en réponse à mon avertissement charitable ? Cette fois-ci non, car une balle vient de claquer, puis une autre encore, et puis une rafale et ce qui est plus grave, un sifflement caractéristique qui succède au claquement. Du coup c’est le vide.
Celte fois la caserne brûle. Tant mieux ! Mitraille à l’extérieur, feu en dedans, les Boches n’échapperont pas ! ! !
Le carrefour des Trois-Croix est important au point de vue stratégique. La caserne est en face et en se défilant le long de la voie ferrée on évite les balles de ceux qui tirent de la caserne.
Les F.F.I. approchent, débouchant par le chemin qui conduit à la route de Châtillon et par le Chemin de Plaisance. On reconnaît Piron, Jansen, Long, Déshormière et tant d’autres dont les noms ne me reviennent pas. Et puis il y a les autres, toute la foule anonyme des maquisards, vêtus de costumes divers, coiffés, quand ils le sont, de calots ou de bérets ou bien encore de képis.
Et la bataille se livre dans toutes les règles de l’art. Les balles crépitent. De la rue Parmentier, de la rue Pouchelon, de la voie ferrée, les F.F.I. déferlent vers la caserne. On la sent cernée. On imagine là-bas, de l’autre côté, au Boulevard Gambetta, nos maquisards à l’abri des platanes, la mitraillette au poing. A l’angle de la rue Lamartine et de la rue Pouchelon, un groupe de F.F.I. surveille. « Ne tirez qu’à bon escient, les gars. Ménagez vos munitions ». A ce moment même, les Boches n’ont plus à les ménager. Je vois d’abord comme un tourbillon de fumée au-dessus de l’usine Grenier, face à la rue Bon, puis c’est un fracas terrible. On a juste le temps de se coucher et c’est une pluie de pierres.
On porte la nouvelle aux sections de tirailleurs, route de St-Paul.
Boulevard Gignier, on nous appelle. Il y a des blessés boches. Ils sont trois, pas gravement atteints, mais sérieusement inquiets. Ils ont tellement peur des « terroristes ». De ce mot ils ont plein la bouche, c’est à croire qu’on leur a sérieusement bourré le crâne.
Et la sempiternelle jérémiade commence sur le leit motiv : « Je suis Alsacien, je suis Polonais incorporé de force. Le troisième n’ose nier sa « qualité » d’allemand et implore : « On ne va pas me fusiller ». Décidément, ils sont aussi abjects vaincus que sadiques vainqueurs.
Plus loin, des F.F.I. ont capturé un major commandant allemand et sa secrétaire alors qu’ils cherchaient à s’enfuir. Le chef de groupe téléphone pour savoir ce qu’il doit en faire. L’officier est blessé légèrement.
Peu après l’auto de la police F.F.I. arrive et on embarque Werner (c’était le nom du commandant) et sa secrétaire.
C’est le dernier épisode de la prise de Romans vue des Trois Croix.
Et le soir, un de ces soirs d’été, dans notre coin calme il ne semble pas que la bataille ait eu lieu là à deux pas.
Dans le terrain de la Cité trente-deux cadavres allemands sont alignés. On creuse les fosses, sur le mur du parc Blain on a déposé les pièces d’identité. On donne aux Allemands une sépulture décente et l’abbé Lémonon fait les gestes traditionnels et prononce les paroles sacrées.
Quand on pense aux charniers de Buchenwald et de Dachau, aux fours crématoires, aux chambres à gaz, on ne peut s’empêcher de mettre deux scènes en parallèle : la fosse et le prêtre d’un côté, le charnier et le nazi de l’autre… Non, nous ne sommes pas de la même race. Nous sommes des civilisés, eux ce sont des barbares ; nous sommes des humains, eux sont des bêtes. Et ces gens là auraient gouverné le monde ?…
**
UN BRILLANT EXPLOIT PARMI TANT D’AUTRES
(mon Journal)
Dans une habitation de la rue Palestro toute la famille est là réunie. L’impatience est grande, l’enthousiasme débordant. On attaque les Boches et la famille Chartier qui a servi depuis le premier jour la dissidence vibre enfin à l’arrivée de ce jour tant attendu.
Que d’armes cachées, que de maquisards camouflés sous ce toit, que de camions partis du garage pleins d’hommes ou de munitions, que de ravitaillement sorti des caves pour nourrir les gars de là-haut.
Il est 9 heures. Certains maquisards sont venus demander des armes. Louis Chartier toujours calme les accompagne au dépôt de la route de Châtillon. Au retour ça tape déjà. A l’angle de la rue Victor-Hugo un cadavre allemand est allongé en travers de la route. Toujours avec le même calme, notre homme lui enlève ses deux grenades à manche et regagne son domicile.
A peine est-il dans l’appartement que Pons, le mécanicien de la maison arrive en criant : « Les Boches ! les Boches ! ».
Tous se mettent aux fenêtres et aperçoivent huit Frigolins qui, en file indienne, l’arme au poing, longent les immeubles sud de la rue Palestro. Venus de chez Citroën par la place Maréchal-Pétain ils ont traversé les bâtiments des repas économiques pour essayer de regagner la caserne. A hauteur de l’établissement Champion, M. Chartier lance par la fenêtre une grenade. L’autre ne se fait pas attendre, Pons l’a déclenchée. Dans l’habitation tous se couchent à terre. Les Allemands se sont abrités derrière la voiture à cheval. Un des leurs est blessé mais il s’enfuit cependant avec ses camarades pour aller se dissimuler derrière un camion en réparation devant le garage Juven. M. Chartier, ses fils et son mécanicien tirent en direction des Boches ; les femmes passent les munitions. Richard Chartier abat un allemand. Les camarades ripostent ; la fusillade est nourrie.
Et, pendant que du balcon de la maison les jeunes occupent les Frigolins, M. Chartier quitte son habitation par une sortie de la rue de la Liberté, pénètre dans le jardin de M. Defour, puis chez Juven. Là, il est presque à hauteur des Boches dont il ne voit que les jambes sous le camion. Il tire sans répit mais sans gros résultat. Mais, voilà qu’il aperçoit une grosse chaudière de gazo contre le mur d’en face, et d’un bond, à travers les balles il franchit la rue. Cette fois les sept Boches sont dans son rayon. Aussitôt trois tombent très gravement touchés et les quatre autres dont un est blessé à l’épaule sortent les bras en l’air en poussant des cris de terreur.
Les prisonniers sont remis, aux F.F.I. qui arrivent et Louis Chartier charge sur sa voiture à bras deux blessés qu’il conduit au Poste de Secours de Notre-Dame.
A son retour il trouve le troisième achevé. Une colère sourde l’étreint ; il ne comprend pas cela.
En soldat de 14-18, il a combattu vaillamment son ennemi. A arme égale, aujourd’hui il a lutté. Mais sur les blessés, l’homme, le Français s’est penché, et devant les cadavres, il a bien vite détourné son regard lorsque de la veste entr’ouverte de l’un d’eux tomba un portefeuille laissant échapper des photos d’enfant…
**
22 AOUT – APRES L’ORAGE
(Journal d’une collégienne, Y. C.)
Les coups de feu ont cessé.
Nous sommes sorties non sans nous être parées de rubans tricolores.
La population délire de joie. Quel vertige dans les rues : tourbillonnements, précipitations, divagations, tel est en ce jour le fond des qualités humaines.
Notre gorge n’est plus étreinte par l’angoisse, aussi laisse-t-elle échapper un rire abondant et heureux.
Nous marchons. Avant le Pont-Vieux nous rencontrons des nègres. L’enthousiasme nous rend hardies. Nous allons les remercier, les féliciter et ils nous gratifient de sourires épanouis et blancs et d’innombrables « coupez-nez », « coupez-oreilles », « coupez-tête » aux Allemands. Nous rions, amusées par cette gradation logique et nous quittons les « y a bon » sur une cordiale poignée de mains.
A Romans, devant le café du Nord un jeune homme porte fièrement à bout de bras, un casque ennemi sur lequel des parcelles de cerveau sont restées collées, parcelles qui étaient quelques instants auparavant le siège des facultés maitresses d’un homme… Mais qu’est-ce qu’un homme !
La côte des Cordeliers fourmille de monde, nous nous faufilons et arrivons place d’Armes, non sans avoir traversé de nombreux groupes, écouté de nombreuses histoires… vraies et goûté quelques amusants concerts.
Nous marchons nonchalamment, sans rien dire, car une joie intense nous étreint, joie intense, et pourtant douloureuse… Mais comment expliquer la complexité de nos sentiments…
Mais voilà qu’un autre spectacle se présente à notre regard. Sur le boulevard, face à l’Avenue Victor-Hugo, une masse verdâtre, flasque et sans forme. Un tas d’allemands gît là. Même de près on, ne voit que du vert. Seule au centre, une main lamentable émerge, une main sanglante, crispée, inoffensive.
Nous longeons le Boulevard jusqu’au collège, çà et là une forme humaine se laisse deviner sous une couverture.
Autant d’ennemis tués.
La guerre a passé par là.
**
LE 22 AOUT A BOURG-DE-PEAGE
(mon Journal)
Bourg-de-Péage avait le privilège de ne point avoir de casernement allemand, ce qui n’empêchait point les boches d’y patrouiller, d’y perquisitionner.
Romans, seule, avait une garnison allemande à déloger et voilà pourquoi c’est à Romans seulement que se sont déroulés les combats de la Libération,
Toutefois, ce jour-là à Bourg-de-Péage, la Cie Geo qui gardait pendant les opérations de Romans la Maladière, a eu un accrochage avec un camion allemand. Les maquisards ont tiré, mais, insuffisamment armés, ils ont dû se replier, le camion ayant forcé le barrage. Malheureusement, sur leur passage, les boches tuent le cantonnier, M. Aimé Blache et une mère de trois enfants, Mme Bourdin de la commune de Châteauneuf-d’Isère.
Le 22 août fut donc marqué à Bourg-de-Péage par la mort de deux innocents civils.
A 14 heures, Gaston Quiron était fusillé à la Maladière. Il faisait partie du service de récupération de la main-d’œuvre française pour le compte des allemands. Il a reconnu avoir envoyé des ouvriers en Allemagne et avoir touché pour ce travail 3.000 francs par mois.
**
23 AOUT. ALERTE !
(Journal du capitaine Abel)
Mercredi 23 Août ! Dans Romans apaisée où se sont tues les dernières rafales de mitraillettes, on pavoise, on rit ; on se surprend à bavarder amicalement avec des inconnues dans la joie d’exprimer sans détour ce que quatre ans d’oppression, de méfiance avaient refoulé au plus profond de soi ; dans les rues, des maquisards, beaucoup trop de maquisards, car pour les anciens il est clair que dans la foule des glorieux soldats sans uniforme se sont glissés des héros de dernière heure dont les fusils et mitraillettes s’étaient enrayés pendant des mois : ceux du Vercors, ceux de la Drôme-Nord les regardent avec mépris, sinon avec colère ; l’heure n’est pas encore à la justice, elle est toute à l’ivresse de la victoire.
Cette joie n’est cependant pas sans nuage ; dans la vallée du Rhône refluent les détachements de la 19e armée allemande, pilonnés par l’aviation alliée, talonnés par les blindés américains, décimés par les maquis échelonnés le long de la Nationale n° 7. Les F.F.I. tiennent Romans, mais les Boches sont à Tain, Tournon et Valence ; les flèches indicatrices donnent Romans, Valence 18 kms, Romans-Tain 18 kms ; la tentation pour le commandement allemand de dégager la route nationale 538 qui par Romans-Peyrins-Beaurepaire aboutit à Lyon, doit être singulièrement forte ; tentation aussi de retarder l’avance alliée vers le nord en faisant sauter les ponts de Romans-Bourg-de-Péage. Un seul obstacle, le hérisson de Romans tenu par les F.F.I.
Ce hérisson, fragile hélas par suite du manque d’armes lourdes est couvert à la périphérie, par des détachements légers ; sur le plateau, encadrant de part et d’autre la route de Tain, des groupes de maquisards veillent. Le 23 août, vers 15 heures, des coups de canon claquent à l’ouest de la ville ; des rafales de mitrailleuse répondent. Comme une traînée de poudre se répand la nouvelle : »Les mongols attaquent par la route de Tain ! ». L’alerte est sérieuse ; une automitrailleuse boche s’est avancée jusqu’à un kilomètre du passage à niveau ; prise à partie par une mitrailleuse, des fusils-mitrailleurs, elle fait front et la précision de son tir oblige bientôt les mitrailleurs à abandonner leur position ; la maison bourgeoise à façade rouge sang du quartier des Bruyères voit voler son crépi en éclats ; peu à peu les rafales de F.M. s’espacent impuissants par manque de moyens, les gars du maquis décrochent et replient les uns sur la Vernaison, les autres sur les Balmes. Pour les quartiers de l’ouest commence le premier exode et bientôt les routes de Mours et de Génissieux voient défiler vélos, remorques, voitures d’enfants. A quelques centaines de mètres du passage à niveau, une maison flambe. Des Sénégalais, en renfort, s’avancent prudemment vers la voie ferrée. Les Boches ne dépasseront pas le passage à niveau. S’agit-il d’une colonne en déroute, essayant de se frayer un passage vers Romans ? S’agit-il au contraire d’une reconnaissance venant tâter les défenses de l’ouest ? La deuxième hypothèse semble plausible car quatre jours plus tard, dans un ferraillement de chenilles et un déchaînement de mitrailleuses, empruntant toutes les voies d’accès, même les chemins de terre, les blindés boches pénètrent dans Romans pour y apporter l’incendie, le deuil, le désespoir.
Mais en ce 23 Août un roulement sourd venant des montagnes balayait les inquiétudes ; de Grenoble arrivaient les Américains et la présence des blindés et des lourds canons tractés apportait à tous la certitude d’une libération définitive : ils ne firent que traverser la ville : dans la rude bataille qui se livrait, Romans n’était qu’un pion sur l’échiquier des stratèges.
**
LES FAITS DE LA JOURNEE
(mon Journal)
Aux premières heures de la matinée un Boche en civil, les bras en l’air, est dirigé par un sénégalais, baïonnette au poing vers le commissariat de police. Il s’était caché sur le toit d’un immeuble.
A neuf heures Gérard Morgan, un traître, agent de la Gestapo, arrêté la veille, condamné à mort sur le champ par le commandant Thivollet pour avoir tiré sur les français au cours de la prise de Romans est conduit au pied de Jacquemart par un peloton de Sénégalais pour y être exécuté. Il est fusillé en traître, de dos, les mains liées.
Le canon tonne toute la journée en direction de Valence et de Tain. Des explosions violentes font trembler les vitres. A 10 kilomètres de chez nous, à St-Marcel-lès-Valence, les boches fusillent sept patriotes dans la cour de l’école. La première voiture américaine arrive à Romans à 16 h. 30.
Le soir nous écoutons à la radio un reportage de la prise de Paris par les F.F.I. Nous entendons une vibrante Marseillaise. Et c’est le cœur gonflé de joie et d’émotion que chacun écoute notre hymne national chanté pour la première fois sous les couleurs françaises.
Tout la nuit ce sont des colonnes entières de blindés américains qui traversent notre ville dans l’enthousiasme général. Nous sommes sauvés ! et après avoir salué nos libérateurs de la veille, nous acclamons ceux qui, avec leur matériel, nous apportent plus de sécurité… du moins nous le pensons… mais hélas, les Américains et leur matériel n’ont fait que passer, et le…
**
24 AOUT
Ce ne sont plus que quelques jeeps rapides qui sillonnent notre cité. L’enthousiasme demeure en ville, mais on s’inquiète beaucoup toutefois du sort de nos valentinois qui doivent être en pleine bagarre.
Le canon ne cesse de gronder. Nos F.F.I. ont eu de grosses pertes à Saint-Marcel où les allemands ont sérieusement tapé. Nous sommes sans nouvelles de Déshormières qui s’est vaillamment battu le 22 août devant la caserne.
Funérailles des. premières victimes de la libération : le lieutenant Jean Georges, le lieutenant Roger Lissandre, Joseph Ferveur, René Boisse, Louis Flachet. Dans son enthousiasme la foule n’a pas oublié ceux qui ont payé de leur vie cette libération. La réalité est là, tristement, lugubrement tragique. Devant Saint-Barnard cinq cercueils drapés de tricolore sont alignés sur un char. La foule déborde sur la place Maurice-Faure, sur le quai, rue Pêcherie et jusqu’à Bourg-de-Péage de l’autre côté du pont.
Au cimetière inondé de lumière, l’émotion est plus poignante encore. Les familles sont là, les officiels s’inclinent.
Le silence est coupé par les bruits des départs d’une batterie américaine installée en haut de la Maladière, des avions apparaissent dans le ciel, on se presse. On sent comme une hâte fébrile, une inquiétude chez certains. Ce n’est peut-être pas fini.
Dans l’après-midi, les premières nouvelles de la radio anglaise sont affichées dans le hall du Petit Dauphinois. Le soir nous arrive un journal intitulé les Allobroges et paraissant à Saint-Marcellin. Il remplace dit-on le Petit Dauphinois. Nous ne voulons y croire.
A 18 h. 30 le mortier se met à taper… et les coups se rapprochent. Dans le haut de la ville les passants s’affolent. C’est en effet bien le canon qui tire sur la ville et alors même que nous essayons, de réaliser, l’alerte sonne. Nous regagnons les caves.
Au bout de trois quarts d’heure, fin d’alerte, et nous apprenons que M. et Mme Véhier et leur fils, concierges au stade des Méannes ont été tués par les obus. Les allemands tiraient sur un train F.F.I. en gare. Le haut de la ville et le quartier des Méannes ont été touchés. Le train est indemne.
Toute la nuit nous arrivent les échos de la bataille qui se livre dans la vallée.
**
VENDREDI 25 AOUT
(mon Journal)
Toujours réveil au bruit des moteurs et des canons.
Cette fois, c’est bien vrai. Les Allobroges remplacent le Petit Dauphinois. La Liberté le Nouvelliste. Le Sud-Est s’appelle le Réveil et la Dépêche le Travailleur Alpin. Seul le Progrès qui s’est « sabordé » et a su ainsi rester Français nous arrive avec son ancien titre.
Ces journaux portent en manchette : »Les troupes blindées du général Leclerc défilent dans Paris libéré ».
A 16 heures, funérailles des quatre autres victimes de la libération de Romans. Les combattants Bœuf, de Saint-Jean-en-Royans, Blédin André, de Lans, Borial Armorico et un corps non identifié.
Ils reçoivent le même hommage reconnaissant que leurs camarades de la veille : « La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau ».
Le soir, violentes explosions. Les boches font sauter leurs dépôts de munitions de Châteauneuf. De violents combats germano-américains sont en cours dans la région de Crest.
**
SAMEDI 26 AOUT
(mon Journal)
Funérailles d’André Blanc, fils de notre secrétaire de police et de deux sénégalais décédés des suites de leurs blessures. La foule toujours fidèle assiste à cette émouvante cérémonie.
Le journal annonce le couvre-feu pour 22 heures et publie un ordre de l’administration locale et exigeant pour le lundi 28 août l’ouverture de toutes les usines, de tous les commerces de Romans et Bourg-de-Péage.
Dans la soirée, à la suite d’une conférence de presse autour du commandant Thivollet, du capitaine Paquebot, officier parachuté à Vassieux et sérieusement blessé lors des combats, du sympathique Victor Boiron et du lieutenant Adjer, aumônier protestant du 11e cuirassiers, à la question posée : « Croyez-vous que les boches reviennent », Victor Boiron, sombre, inquiet, me répond : « C’est à craindre ».
Il semblait ce soir-là que Victor Boiron pressentait qu’il payerai de sa vie le retour des nazis.
**
LA SITUATION MILITAIRE
(Journal Lieutenant Lagier)
Dès le jeudi à midi, une action est montée avec les américains pour attaquer Valence.
De Romans, la moitié des forces américaines devait prendre la route directe Romans-Valence. L’autre partie, motorisée, devait passer par Romans-Alixan et dans ce dernier village prendre contact avec l’escadron Thivollet qui se trouvait sur la droite. Tous ces hommes rassemblés se dirigeraient alors sur Saint-Marcel tandis que les groupes du Commandant Legrand attaqueraient Valence, soutenus par les américains qui se trouvaient à Crest.
Malheureusement les américains qui devaient gagner Valence par la ligne directe furent refoulés vers Saint-Marcel, et ceux devant passer par Alixan manquèrent le contact avec les pelotons Thivollet. Ils filèrent donc jusqu’à Chabeuil, se mélangeant avec les éléments américains qui, trouvant de la résistance, avaient reculé de Valence sur Chabeuil.
De service au P. C. à la Mairie, je reçois le jeudi à 11 heures du soir un coup de téléphone de l’hôpital demandant qu’un officier s’y rende immédiatement. Je trouve à l’Hôpital le Docteur Morel qui me remet un pli d’un officier américain blessé et qui doit être porté de toute urgence au P. C. américain installé vers Chabeuil. Je pars aussitôt, et au passage à Alixan je vois Jansen qui s’étonne de n’avoir pas vu les américains. Je continue jusqu’à Chabeuil. Le P. C, américain et le P. C. du Commandant Legrand sont installés dans la maison du Docteur Grangaud.
Le Commandant Legrand me fait part de l’échec de l’attaque et des craintes qu’il éprouve pour les éléments français qui ont du s’infiltrer dans Valence. Il a donné des ordres pour faire replier les troupes sur Chabeuil et Crest et me demande de faire connaître ses ordres. Au retour, à Montélier, je peux joindre le groupe Sanglier (Commandant Planas) et lui donner l’ordre de repli. A Alixan c’est le capitaine Modot qui attend toujours les américains.
Arrivé à Romans, je passe chez Boiron pour signaler au capitaine Paquebot l’échec de l’attaque. Il est vendredi, 4 heures du matin. Je reprends la route pour effectuer une reconnaissance vers Valence. A hauteur du café Lebras, je rencontre deux muletiers du groupe Sanglier qui cherchent leur unité.
A Saint-Marcél-lès-Valence, il n’y a pas âme qui vive. J’abandonne ma moto et, par la voie ferrée Romans-Valence, avance jusqu’au kilomètre 5. J’obtiens quelques renseignements : les Boches installent une ligne de résistance. Château Plovier, route Romans-Valence et kilomètre 3.
Au retour à Saint-Marcel, j’arrête in extremis une jeep qui fonçait à 90 kms à l’heure dans le barrage allemand. Dans l’après-midi, nous apprenons que des concentrations de troupes allemandes composées notamment de mongols s’installent vers Châteauneûf d’Isère, au lieu dit du Rozeron.
Samedi j’effectue une reconnaissance sur Crest et, en arrivant à Vaunavey, j’apprends que les. Boches occupent la route : gare de Vaunavey-Crest, et qu’un char allemand a été détruit à 500 mètres de cette gare.
D’autre part, on me signale que les boches, en passant à 4 heures du matin dans un tout petit village voisin, avaient arrêté l’ouvrier boulanger et que celui-ci avait pu s’évader au moment de l’accrochage entre allemands et américains. Je mets tout en oeuvre pour rejoindre cet ouvrier boulanger et j’obtiens alors tous les renseignements sur les positions et l’importance des concentrations de troupes dans cette région.
Dès ce moment-là, nous étions coupés, des Américains et nous ne pouvions plus compter que sur nous-mêmes et la Providence.
*****************************
27 AOUT
Romans – Bourg-de-Péage sont repris
et définitivement libérées le 30
PLACE JEAN-JAURES
(Journal H. D.)
Vers 13 h. 40, alors que je me trouvais chez mon fils, tranquillement assis autour de la table familiale, dégustant un erzats de café national, nous entendîmes un crépitement de mitrailleuses, bientôt suivi d’éclatements de grenades. En même temps un roulement continu de chars traversant la place ou remontant du bas de la ville ajoutait encore à ce bruit infernal.
Malgré les cris d’effroi des femmes et des enfants, nous approchâmes des fenêtres qui donnaient sur la place et nous vîmes des soldats allemands, les uns debout, d’autres assis sur leur tank, scrutant attentivement toutes les fenêtres et ouvertures des immeubles, faisant usage de leurs armes. De rares passants fuyaient à toutes jambes par les rues transversales dès qu’une accalmie se produisait.
De nombreux coups de feu ayant été tirés contre la façade de notre immeuble et des immeubles voisins, brisant les glaces, nous nous sommes tous mis à l’abri derrière le transformateur de l’atelier.
Entendant des bruits de pas sur la toiture, nous y avons trouvé quatre jeunes hommes qui se cachaient et auxquels nous avons donné refuge.
Quelques minutes après, alors que nous entendions des éclatements de grenades de plus en plus rapprochés (nous apprenions bientôt après que ces grenades lancées sur le pâté de maisons du café Roumestan au café Mondon avaient mis le feu à ces immeubles), de violents coups de crosse faisaient voler en éclats les glaces des cafés voisins, puis ce fut à notre porte que les coups s’abattirent.
Nous ouvrîmes. Les soldats nous encadrèrent et nous conduisirent devant leur chef qui se trouvait à la terrasse du café Glacier où par groupes affluaient de nombreux otages.
Après examen de nos papiers d’identité, cet officier nous dit qu’il nous gardait en qualité d’otages n° 1, à sa disposition. Peu après il nous déclara que pour un soldat allemand tué il fusillerait 10 otages. Pour deux soldats, 20 otages et ainsi de suite et que s’il rencontrait une résistance, il ferait incendier la ville.
Se ravisant soudain, l’officier désigna un de ses lieutenants et quatre hommes et ordonna à mon fils d’aller chercher les autorités. Mon fils refusa d’y aller seul et fit part de cet ordre aux otages assemblés. Sans hésitation et courageusement, plusieurs s’offrirent. MM. Chardon et Prat se joignirent à lui et le groupe se dirigea vers la Mairie où, naturellement, ils. ne trouvèrent personne.
A défaut d’autorités civiles ils s’adressèrent à l’autorité religieuse en la personne de M. le chanoine Prudhomme qui me fit aucune difficulté et tous quatre vinrent se présenter à l’officier qui m’avait retenu.
Près de lui, devant la porte du café Glacier grande ouverte, je pouvais échanger quelques paroles avec les nombreux otages effrayés des menaces que venait de nous faire l’officier. Je les exhortais de mon mieux à la patience répondant aussi aux questions que me posait l’officier auquel je demandais pourquoi il faisait brûler les immeubles qui étaient devant nous, lui disant que ces maisons étaient occupées par de paisibles commerçants. Il me répondit que c’était pour l’exemple parce que des terroristes avaient tué des soldats allemands. Il ajouta : « Vous avez imprimé pour les terroristes et pour les américains. II vous faudra maintenant imprimer pour les allemands ». Il me donna alors l’ordre de rentrer à l’imprimerie préparer le matériel pour l’impression d’une affiche, dont voici le texte: J’obéis sous la menace, la mort dans l’âme.
**
AVIS
« La population est avisée qu’elle doit se tenir chez elle de 21 h. à 6 h. 30. Lorsque quelqu’un est appréhendé par un soldat allemand, il doit immédiatement s’arrêter. Celui qui se sauve ou qui n’obéit pas ou qui porte une arme sera immédiatement fusillé. Les drapeaux quels qu’ils soient doivent être enlevés des maisons. A partir de 21 heures, personne ne doit circuler dans les rues. Celui qui cachera un terroriste ou un américain sera fusillé. Celui qui a une arme à la maison doit la donner immédiatement. En cas de désordre, les otages seront fusillés. »
Nous avons travaillé toute la nuit avec un éclairage de bougies et grâce au concours des quelques hommes auxquels nous avions donné asile qui se relayaient pour tourner le volant de la machine, remplaçant ainsi le moteur qui, faute de courant ne pouvait nous servir. A chaque instant nos pensées étaient tournées vers nos braves otages que nous allions de temps en temps réconforter et ravitailler de notre mieux.
Les blindés sillonnaient la place Jean-Jaurès presque sans arrêt; des tanks se plaçaient sur les trottoirs tandis que des pièces d’artillerie s’installaient au milieu de la place. Puis ce fut sous la mitraille que s’effectua le pillage des magasins et appartements abandonnés par leurs propriétaires.
Nombreuses victimes avaient été relevées. Sur le Boulevard notamment, à 14 h. 15, Mme Girard, épicière, était tuée dans son magasin d’une balle dans le dos. Son fils que les allemands visaient avait pu s’esquiver. Quelques instants après il regagnait comme otage le café Glacier, laissant le cadavre de sa pauvre mère étendu dans la boutique.
(vu par M.Mondon)
« Je rentrais de courses à 13 h. 35 quand une rafale de mitrailleuse balaie la place. Je vois tomber face au café Failherey le capitaine Janin. Il paraît mortellement atteint et aussitôt après j’aperçois des tanks allemands qui débouchent de l’avenue Duchesne et atteignent le Café Glacier. M. Roux, coiffeur, qui veut enlever ses drapeaux est tué à sa fenêtre. J’examine encore quelque peu de ma cuisine, mais deux obus atteignent l’immeuble, il faut descendre à la cave. La fusillade s’accentue. Un fusil mitrailleur installé devant l’Economique balaie de ses rafales la rue Jacquemart et la Place. Nous entendons les bruits de pas au-dessus de nos tètes : les soldats allemands pillent les magasins. Bientôt des crépitements arrivent jusqu’à nous : je m’informe, la moitié du toit de chez Prat est en flammes. Il faut quitter la maison, dix-neuf personnes sont alors sorties par les toits dont ma femme, grande malade depuis déjà plusieurs mois.
Le feu gagne petit à petit et toujours par les toits nous atteignons le troisième étage d’un immeuble de l’avenue de la Gare où nous passons la nuit.
Le lendemain seulement, un jeune homme des équipes d’urgence m’apporte un brancard, et sous les balles je transporte avec mon fils ma malade jusqu’au passage à niveau où on me prête une brouette et plus loin un charreton. »
Voici le douloureux chemin parcouru en ce 27 août par un pauvre homme qui avait tout perdu : son commerce, ses meubles, ses vêtements, son argent et disputait à la mort, par le feu ou le fer de la guerre, une malheureuse femme qui devait mourir peu de temps après du mal qui la minait.
**
UN BOCHE EST TUE SUR LE BOULEVARD
Dès les premiers obus tirés sur Bourg-de-Péage, le gendarme Laulagnet avait envoyé à Romans trois jeunes : Puzin, Dard et Françon chercher le fusil-mitrailleur du Groupe. En rien de temps, nos jeunes étaient en possession de leur F.M. et pensaient déjà revenir au Péage quand, à côté de l’Alhambra ils se trouvent face à face avec une colonne de chars et de voitures chenilles transports de troupes qui se dirige vers la caserne. Que faire ? Leur position est vite prise puisqu’on ne peut rentrer au Péage on se battra ici. Entre temps le petit groupe s’est grossi de 4 hommes rencontrés en chemin, dont un facteur. Immédiatement Puzin met en position le F. M. et appuyé par ses camarades armés de fusil il ouvre le feu sur les voitures. Un boche est touché, il tombe mortellement atteint. Ses camarades sautent à terre, essaient de le hisser sur la voiture au milieu des gerbes de balles crachées par le F. M. Près de 40 chargeurs sont tirés.
Mais voilà que les chars voisins dessinent une manœuvre d’encerclement et protègent les boches du feu de leurs mitrailleuses. Les jeunes Français sont pris à revers par un char qui passe rue Palestro et sans abandonner leurs armes, ils se précipitent dans le couloir des maisons voisines, mais en exécutant cette manœuvre Roger Françon tombe mortellement frappé. Ses camarades, plus heureux, gagnent les toits où ils passeront 48 heures puis regagneront l’Alhambra.
Route de Tain, vers 14 heures, les dissidents se replient sous le feu des batteries allemandes. Martin Hubert est tué, son camarade Gaston Lapassat est sérieusement blessé. Il mourra le 30 août.
Route de Mours, vers 14 h. 30, les tanks arrivent. On s’affole. Un brave homme qui se rendait au Ravitaillement en ce beau dimanche de liberté se cache derrière un portail, il s’agit de M. Deberty, de Bourg-de-Péage. M. Maurice Faure, qui habite non loin le rejoint. La famille Faure est aussi à leur côté. Mais voilà que de sa tourelle l’officier allemand a vu les deux hommes. Il les appelle, et bien que nos deux compatriotes se présentent aux boches les bras levés une rafale les couche sur la route.
**
A L’HOPITAL DE SECOURS DE LA RUE GUIBERT
(journal Ch. Chaze)
Le 27 août, à 13 h. 30, les 29 malades et blessés ayant pris leur repas l’après-midi s’annonçait calme dans l’intérieur du petit hôpital, malgré la souffrance de plusieurs bombardés de St-Vallier, très sérieusement choqués, à bout de nerfs.
Brusquement crépitent des coups de feu, ils s’amplifient, les membres du personnel s’entreregardent atterrés. Que se passe-t-il ? Après une seconde d’immobilité on se précipite aux fenêtres : oh ! tragique et inoubliable spectacle : à l’endroit où 5 jours avant notre pauvre voisin a trouvé la mort, surgit massif, horrible et triomphant un « Tigre » chargé d’hommes gris, au casque trop bien connu !… et dans le bruit de la mitraille, avec des salves de coups de canon qui se rapprochent, cette marée ennemie déferle devant nos yeux pendant deux heures et demie !…
On verrouille la porte ; on ferme tant bien que mal les volets intérieurs. On entend les ordres brefs en langue barbare ; les chars passent toujours dans un fracas d’enfer, horrifiant les « bombardés ». Ils nous ont repris ! oh quel malheur !…
Mais ce qui achève les nerfs des pauvres blessés ce sont les coups de canon qui ont l’air de se concentrer sur cette partie de la ville : nul doute, il faut descendre dans le vestibule d’entrée à défaut de cave. Il n’est plus question d’aller rejoindre l’abri à 200 mètres.
Les blessés descendent l’escalier ; à ce moment, dans un grand fracas toutes nos vitres volent en éclat et nous sommes couverts de débris ; un obus vient d’exploser à 5 mètres de nous, emportant une partie du toit de la maison voisine et deux morceaux de notre façade. Nous retrouverons 4 jours plus tard dans une pièce heureusement vide d’énormes éclats de 155.
Un grand blessé de Saint-Vallier se met à pousser, ainsi que sa femme, de véritables hurlements de détresse. Tous deux sont restés plusieurs heures le 16 août écrasés sous les décombres de leur maison de St-Vallier qui a gardé ensevelis deux de leurs enfants ! ajoutez qu’ils sont rescapés de Toulon ! Il leur est impossible de supporter pareil tourment : ce fracas des obus leur fait revivre le cauchemar des bombes.
Rassemblant tout leur courage et chacune pensant ne pas redescendre vivante, l’infirmière-chef et une aide s’élancent dans l’escalier pour redescendre péniblement de son second étage le blessé roulé dans une couverture sur son matelas. Accalmie d’obus pendant l’installation misérable dans le vestibule.
Le déferlement des chars étant apaisé, 3 Allemands… accompagnés de 2…. Français (oui, hélas !) demandent à infirmière-chef, penchée à la fenêtre du premier étage : « Dissidents ici ? » Non, bombardés de Valence et de St-Vallier. – Bien vrai ? – Vous pouvez venir voir si vous voulez, dit-elle calmement.
Ils parlementent, puis s’éloignent. L’infirmière redescend : pas une minute à perdre, il faut cacher le seul soldat resté ici cet après-midi, Antoine, grand nègre du Congo, du plus beau noir, doux, calme, toujours souriant, « jamais peur ».
C’est ainsi que l’aide infirmière ayant fait ces deux montées qu’elle redoutait dut faire la troisième en compagnie du nègre Antoine, jusqu’aux combles de la maison.
Antoine, le noir, dans sa cachette avait des chances de s’échapper si comme nous le craignions l’hôpital annexe était visité par les « vert de gris ». Une fois installé sur un petit escalier, en compagnie d’un litre de vin, notre noir s’écrie : « j’ai oublié quelque chose ». – Où ? je vais le chercher. – « Non, dit-il, Antoine y va » et nous redescendons craignant à chaque instant d’entendre en bas des bottes et des voix sauvages, pour prendre dans la chambre, savez-vous quoi ? un éventail rose, dont il se saisit avec son inaltérable sourire.
Croyez que j’avais une envie folle de gifler ce grand enfant noir !
Vers 18 heures, de l’hôpital on vient : « il n’y a pas de morts ? ni de blessés ? On se demandait ce que vous étiez devenus ! Venez vite. »
Et c’est l’évacuation plus lamentable que celle du 22, mais cette fois en sens inverse, vers le grand hôpital qui va nous protéger quatre jours durant dans les profondeurs, hélas, bien lugubres, de ces noirs et humides souterrains.
L’annexe est abandonnée à son délabrement.
Mais l’hôpital à aucun prix ne veut Antoine, le noir. Notre voisin nous le fait cacher dans un lieu indécouvrable et tous les jours il faudra user de ruse pour aller le ravitailler….
**
A L’HOPITAL
Peu avant notre évacuation de la rue Guibert, vers la fin de l’après-midi, un groupe d’officiers arrogants avait pénétré dans la cour de l’Hôpital, en voiture et demandé les américains. Plusieurs de ceux-ci s’étaient dissimulés de leur mieux dans le pavillon des enfants. Les officiers allemands, toutefois, en appréhendent deux qu’ils font sur le champ ranger dans la cour bras levés. M. Gourbon, infirmier est sommé de s’immobiliser auprès d’eux dans la même position.
Puis c’est la visite des salles, des sous-sols pendant que les trois otages gardent les bras levés sous la menace de deux mitraillettes braquées sur eux.
Cette visite, qui paraît visiblement longue, a un double but : rechercher d’autres blessés américains mais surtout visiter les blessés allemands. Ces derniers sont trouvés installés dans les plus profonds des souterrains, c’est-à-dire en lieu sûr et soignés convenablement. L’inspection finie, les officiers réapparaissent dans la cour, leur visage est moins dur. Ils délivrent M. Gourbon, encadrent et emmènent les deux américains mains croisées sur leur tête.
Une heure après, environ, un tank ennemi pénètre dans la cour. Un groupe d’officiers et soldats ramène un des américains reconnu par eux malade, ils ont gardé son camarade prisonnier. Cette fois, les boches ont une allure moins menaçante. Un groupe se dirige à nouveau vers les souterrains ; ceux qui demeurent en faction dans le tank ont des visages « humains » et la relative « bonne humeur » de tous doit être soulignée, car elle signifie que les hommes valides de l’hôpital seront peut-être laissés libres… que les rigueurs subies par la ville seront… peut-être… atténuées.
C’est exactement ce que déclare après une seconde inspection dans les souterrains un de leurs officiers au directeur de l’hôpital. « Blessés allemands bien soignés, alors ville pas brûlée ». Et ils remontent tous à bord de leur infernale machine sur ces mots qui allègent notre poids d’angoisse.
Les officiers et leurs hommes ne se sont pas, à l’hôpital, contentés d’observer lieux et gens ; ils ont fait parler leurs hommes : nourriture, soins, attitude des docteurs et du personnel, tout est enregistré. Des infirmières qui suivent de près les grandes lignes de la conversation et entendent les blessés répondre aux questions précises et insistantes de leurs compatriotes : « oui, bien soignés » se réjouissent d’avoir agi strictement en infirmières, soignant bien leurs blessés, quels qu’ils soient.
Une remarque en passant pour être en tous points fidèles à la vérité les blessés n’avaient reçu les premiers jours de leur hospitalisation ni pain, ni vin. Plusieurs personnes, la mère supérieure en particulier, firent remarquer qu’il était juste et préférable de ne pas faire cette exception pour les blessés. L’heure des représailles étant sonnée, beaucoup de témoins se souvinrent avec satisfaction du changement de régime alors intervenu.
Le traitement humain des blessés allemands à l’hôpital a donc été pour une grande part dans l’atténuation relative des mesures de représailles pour Romans.
**
AUX TROIS CROIX
(journal R. Bastide)
Il fait très chaud. A Châtillon, on mange sous la charmille. Tout à coup des bruits de balles arrivent jusqu’à nous. De Romans-Bourg-de-Péage, des nuages de fumée montent par place. On entend des explosions.
Vite en bas et le vélo enfourché, en route pour la ville.
Le village de Châtillon est en effervescence. Des F. F. I. sortent des maisons les armes à la main.
« Qu’y a-t-il ? Les Boches attaquent Romans !…. – Pas possible… – Mais si ! »
Dialogue bref, rapide, qui en dit long… et qui me donne en même temps qu’une immense angoisse, des ailes.
La route est déserte. Les balles sifflent] Vite au chemin, de Plaisance. Là, c’est une autre histoire. Les F. F. I. et les Boches tiraillent. Vais-je arriver ? J’y tiens essentiellement. J’ai laissé chez moi toute la famille, avec un tas d’impédimenta, tels que casques destinés aux F. F. I., articles et documents anti-boches sur mon bureau, listes d’F. F. I. pour une distribution d’argent à leur famille, et, naturellement le drapeau. Auront-ils eu le temps de tout « planquer ». Y auront-ils seulement pensé ?
Décidément je n’arriverai pas !! Cache-toi, bougre…. (je n’ai pas entendu le reste) me crie un F.F.I. accroupi dans un fossé, l’arme à la main.
La ferme Pin est là. Tant pis, halte. Je pose le vélo et à pied par les vignes, à la Grâce de Dieu. Les vignes sont hautes, les maïs aussi et grâce à eux j’approche des Trois Croix.
. Je tombe sur un groupe d’F. F. I. Je puis leur fournir quelques renseignements que j’ai recueillis au cours de nombreux « plat ventre » prolongés qui m’ont donné tout loisir d’observer la position des boches.
Là-bas est la tranchée de Miny. J’y rentre. Nous sommes une dizaine dans la remise face au chemin, un chemin qui fait angle droit avec celui de Plaisance, alors parallèle à la voie ferrée. Et on attend… pas longtemps. Au moment où je me décide à un nouveau bond qui me conduira aux Trois Croix, je vois une automitrailleuse suivre le chemin de Plaisance. Horreur ! Elle tourne dans le chemin. Fermons vite la porte. L’auto s’est arrêtée face à la remise; les hommes se dressent, les mitraillettes dirigent leur canon vers nous et c’est la rafale impitoyable et aveugle. Un homme, M. Cheval, tombe à mon côté. On s’écrase contre le sol, on voudrait s’enfoncer dans cette terre battue qui résiste.
Mais il y a quelque chose de plus tragique, de plus pénible pour nous que la rafale, c’est l’attente après le « cessez le feu ». Oh ! ce silence lourd d’angoisse… Que va-t-il arriver ? Va-t-on les voir faire irruption ? Et alors !
L’auto s’ébranle. Oh ! le bienfaisant bruit de moteur. Et comme l’homme est égoïste… Plus loin les coups crépitent encore. Cette fois c’est la tranchée de Miny qui est attaquée. Là, pas de morts, mais beaucoup de blessés, des femmes en particulier. Des otages sont emmenés.
Et c’est de nouveau le calme après la tempête. Une sentinelle se promène le long de la voie ferrée. Nous l’apercevons par la porte entrebâillée.
Tant pis, sortons, on verra bien. Tout plutôt que cette attente, car mon terrible souci n’a pas cessé. N’ont-ils pas tout fusillé et brûlé chez moi ?
J’entends des cris. Des femmes passent ensanglantées avec des pansements sommaires. Elles ont été blessées dans la tranchée de Miny.
Cette fois-ci nous sortons, nous chargeons les blessés sur notre dos ou nous les prenons par le bras. On verra bien si la sentinelle tirera. Elle ne tire pas.
Et nous arrivons à la maison. Ils ont mitraillé la façade, mais ils ne sont pas entrés. Naturellement tout est encore en place comme quelques heures avant au moment de mon départ pour Châtillon.
Un poste de secours est organisé en vitesse.
Et nous avons vécu une nuit de bêtes traquées…. Jusqu’à mercredi nous avons été particulièrement arrosés aux Trois Croix, Route de St-Paul, à la Cité, Boulevard Gignier par l’artillerie américaine. Nous les sentions très près et nous avions bon espoir et bon moral.
On sentait que malgré ses derniers ressauts, la bête nazie était touchée à mort.
**
A LA GARE, UNE TRISTE DESCENTE A LA CAVE
(Journal de J. Chapus, chef de Gare)
Le 27 août 1944, après déjeuner, la chaleur accablante m’avait incité à faire une petite sieste.
Mon fils, blessé aux deux jambes lors de l’attaque de là caserne Bon, le 22 août, sommeillait dans la chambre à côté.
Brusquement, vers 13 h. 30, une fusillade nourrie accompagnée de bruits de moteurs inquiétants, nous fait dresser sur nos lits.
Ma femme accourt pour m’informer.
Inutile, j’avais compris sans peine. Ce que nous craignions depuis cinq jours, venait de se réaliser.
Les chars boches contre-attaquaient Romans.
Je savais parfaitement que nous ne possédions aucune arme anti-chars et que les blindés américains n’avaient fait que passer dans notre ville.
La situation était donc grave ? Les Boches avaient certainement des idées de représailles et, connaissant leur douceur…
Mon premier geste fut de retirer la douzaine de drapeaux qui pavoisaient la gare – nous avons appris quelques minutes plus tard que sans cette précaution nous aurions certainement été gratifiés d’une série d’obus tirés à bout portant.
Je descends à mon bureau devant lequel les agents en service sont rassemblés et me questionnent du regard.
Que faire ?
Pour ma part, aucune hésitation. Je reste sur place. Ils font de même.
Par le téléphone S.N.C.F., je prends sur moi d’alerter les Forces Américaines qui occupent la gare de Grenoble.
Il est difficile de s’entendre. J’insiste. On me demande le nombre de chars attaquant, leur type, etc..
Les deux guerres m’ayant laissé une certaine compétence technique, je fournis des chiffres imaginaires mais qui se révélèrent à peu près justes (j’avais tablé sur un bataillon normal de chars).
On me questionne toujours. J’insiste encore sur l’urgence, parlant de massacre… On se comprend mal au téléphone. Heureusement M. Dubourdeau, Surveillant du S. E. de St-Marcellin est sur la ligne; il me relaie. Puis, brusquement, plus rien. La ligne est coupée…
En ville, la fusillade continue, ponctuée de coups de canons tirés par les chars. Certains quartiers flambent. Des automitrailleuses franchissent le passage à niveau vers Mours. Nous nous plaquons dans les embrasures des portes pour éviter des rafales éventuelles. Le café des négociants est gratifié de 3 obus tirés à 10 mètres (il n’avait pas enlevé ses drapeaux).
Quelques instants plus tard, une femme passe en courant et nous lance : « Ils prennent des otages et vont les fusiller ».
Diable ! ça s’aggrave. Nous les observons monter le long de l’avenue de la gare. Ils enfoncent certaines devantures à coups de crosse et emmènent des personnes.
Sachant que les cheminots sont assez recherchés comme otages et pouvant constater que ces « Messieurs » étaient réellement de mauvaise humeur, je décide de dissimuler tout le monde dans ma cave en attendant que l’orage passe.
Au nombre d’une dizaine, nous rejoignons mon fils blessé que j’avais dès le début descendu sur mes épaules.
Soirée et nuit angoissantes. Nous entendons les bottes Felgraud sur nos têtes. Viendront-ils jusqu’à la cave ?
A l’aurore, tous mes invités à bout de nerfs ont quitté les lieux pour se dissimuler dans la campagne.
Je reste seul avec ma famille. Plus que jamais nous sommes décidés à rester. Et cela malgré l’avis publié dans la journée que toute personne abritant un maquisard serait fusillée.
Nous nous organisons.
Je reste à la cave avec mon blessé. Comme armes, un revolver chacun (dernier recours).
Ma femme se tiendra dans son appartement et autant que possible mon junior fera la liaison.
Le lendemain, une vingtaine de wagons de matériel de guerre brûlent dans la gare. S’il y a des explosifs, nous sommes « frits »…
Heureusement, il n’y avait que quelques cartouches qui, en explosant, faisaient jaillir des étincelles peu dangereuses.
Une dizaine de wagons sont placés sur une voie qui longe les bâtiments. S’ils sont incendiés, toute la gare doit y passer. Les Allemands les fouillent. Il y a pourtant du matériel de guerre. Ils brisent des caisses à coups de haches, mais n’y mettent pas le feu. Ouf !…
Par deux fois ils pénètrent dans le couloir qui fait suite à mon bureau et viennent à la porte de la cave que nous avions fermée à clef par l’intérieur.
Ils grattent à la porte. Vont-ils l’enfoncer ? Non ! Ma femme se montre sur le palier et ils se retirent en grognant.
Ils prennent un de nos vélos. Ma femme intervient et réussit à se le faire rendre.
Entre temps, en bonne diplomate, elle panse un de leurs blessés. Mais, vraiment, nous avions eu de la chance de tomber sur des ennemis ayant un verni de civilisation.
Malgré cela, ils se livrent à un pillage en règle du magasin G.V.
Quarante-huit heures se passèrent ainsi !
Mon fils ainé et moi, au fond de la cave. Les Boches dans mon bureau exactement au-dessus de nos têtes. Ma femme en faction sur le palier et mon jeune fils faisant de temps en temps les cent pas sur le trottoir de la gare.
Il était convenu que lorsqu’il verrait les « Frisous » s’éloigner, il sifflerait un air connu en passant sur notre soupirail.
Pauvre fiston… Je le gronde souvent parce qu’il siffle, même en faisant ses devoirs. Mais à ce moment nous aurions voulu l’entendre sans arrêt.
Au troisième jour, les obus sifflent à l’est de Romans et c’est bien la première fois de ma vie que je ne trouve pas ce sifflement désagréable.
Les secours arrivent. Les Allemands réintègrent leurs chars et nous sortons enfin de la cave, transformés en Sénégalais par la poussière de charbon.
La canonnade dure toute la nuit. A l’aube du 4e jour, elle devient furieuse.
Enfin, avec un soulagement non dissimulé, nous entendons le roulement de ces maudits blindés qui évacuent la ville en longeant le Cours Bonnevaux.
Peu après, les premiers Américains et F.F.I. pénètrent dans la gare méfiants et assoiffés.
Pour Romans, c’était la fin de la tourmente.
**
IMPRESSIONS D’UN OTAGE
(Journal M. Bernard-Brunel)
C’est un beau dimanche. Romans est libre. On a flâné en ville dans la matinée ; on a déjeuné tard et on se dispose à flâner encore.
Brusquement, mes vitres tombent, hachées menu par une rafale de mitrailleuse. La maison est criblée de balles et peu après, une escouade entre dans mon jardin et vient m’extraire de l’abri où je m’étais réfugié avec ma famille.
Quelques minutes difficiles… le gros revolver braqué sur moi. Que me veut-il de son œil noir dans ce décor si familier, au pied du cèdre si pacifique où je suis debout ? Enfin, je suis emmené, seul, le long du boulevard vide jusqu’au groupe morne des otages qui stationne entre deux blindés. Il va peut-être falloir mourir devant le mur de la caserne à moins que ce soit un peu plus loin. Cette éventualité amène dans l’esprit un torrent de réflexions qui s’enchaînent, se croisent, se mêlent en tumulte, tandis que les sens comme libérés enregistrent pour leur propre compte des images décousues, mais précises et nettes. Une lourde hache enfonce une porte, des coups de feu claquent, des blindés passent à pleins gaz ; une auto brûle sur la place, un cadavre barre l’entrée d’un café, des flammes jaillissent d’une vitrine. On est un peu rassuré quand on se trouve si nombreux devant le Glacier : 200 environ, qui, pour le moment, écoutent la proclamation. Notre situation est fixée : nous sommes là pour garantir la sécurité des troupes allemandes. Qu’une bagarre éclate en ville et ce rendez-vous finira comme tant d’autres, pour quelques-uns ou pour tous par un feu de salve à l’aube, à moins qu’on nous réserve pour des choses plus raffinées.
En attendant, on nous installe à l’intérieur du café, pendant que la nuit tombe, et que, en face, l’incendie librement se développe. On voit de temps en temps rougeoyer brusquement tous ces visages hâves, quand un jet de flammes s’élève et quand l’obscurité revient, on oublierait presque que cette salle contient une foule. Le moral dans l’ensemble est bon. Les conversations vont leur train et on cherche à voir ce qui se passe au dehors. Très tard, la pompe intervient pour limiter l’incendie et son halètement tout proche est comme la respiration douloureuse de la ville. On apprendra plus tard que les habitants sinistrés ont pu fuir par les toits assez tôt.
La nuit se passe ainsi et l’aube du lundi n’apporte rien de nouveau. Quelques imprudents qui se sont risqués hors de leur demeure nous rejoignent, et peu à peu arrivent des nouvelles et des vivres. Entre temps la salle a été décongestionnée en ouvrant le local des réunions au premier étage avec libre circulation dans l’escalier. En haut on a plus d’air, plus d’espace, plus d’illusion, mais on est moins près de la rue et des gens qui maintenant passent librement devant la porte. Du balcon on voit un avion américain qui fait sa promenade et que le canon guette. Quelques coups rageurs emplissent la maison de leur fracas : l’avion hésite comme s’il avait été touché, mais non il pique franchement vers l’est et tout le balcon applaudit. D’en bas on n’a rien vu et les gardiens n’ont pas remarqué notre réaction.
Le lundi soir, les bruits les plus divers circulent. En fin de compte on libère les plus vieux et les plus jeunes. La ville ne nous oublie pas. De notre groupe quelqu’un nous compte…. et c’est pour moi le plus mauvais moment. Cette sélection inquiète tout le monde.
Dès ce moment, l’idée m’est venue de partir aussi et je me suis mis en faction près de la porte pour guetter l’occasion favorable qui s’est présentée peu après… J’ai parcouru seul, cette fois, le boulevard et en sens inverse, réprimant une envie folle de courir à perdre haleine. Pour les autres, cela a duré jusqu’au surlendemain.
**
B0URG-DE-PEAGE : 27 AOUT L’INVASION
(Mon journal)
Si Bourg-de-Péage n’avait pas connu les combats de la Libération, le 27 août fut dans cette ville chèrement payé tant par les dissidents que par les civils. La petite cité fut moralement et matériellement martyrisée.
Les boches ont envahi Bourg-de-Péage par le Vieux Pont venant de Romans. Les blindés arrivant par les Recollets et tirant de Bellevue ont tenu Bourg-de-Péage sous leur feu ; puis au Vieux Pont ils ont tiré sur l’immeuble Mazade ; un obus a également touché la Mairie pavoisée et le clocher de l’église. Puis ils ont fait jonction à la Maladière avec les transports de troupes venant de Châteauneuf et la horde barbare s’est répandue dans la ville tuant, pillant, brûlant tout. Des reconnaissances ont été poussées sur Saint-Nazaire, Bésayes et les petites localités… Partout la terreur et la mort.
**
TROIS JOURS DE TERREUR
(Vécu par le gendarme Laulagnel, F.F.I. très actif qui, sans bruit, en vrai français, a rendu tant de services à la dissidence)
13 h. 30, mon attention est attirée par le crépitement de F. M. qui se mettent à tirer rageusement. Le bruit vient de la rive droite de l’Isère et je le situe vers le Pont de Vernaison où est en position un escadron du 11e Cuir. Presque en même temps j’entends des coups de canon. Je me précipite dans les escaliers conduisant au bureau de la Gendarmerie où se trouve le groupe de police F.FJ. dont je suis le chef adjoint. L’affolement règne. Les familles des gendarmes demandent la conduite à tenir. Les coups de canon se rapprochent. On entend en même temps le départ et l’arrivée de l’obus et à ce bruit bien caractéristique des armes à tir tendu, je réalise que la ville est attaquée par des chars.
A peine quelques minutes se sont écoulées depuis le début de l’alerte que le premier obus s’abat sur la maison Charras, rue Chéradame. Un nuage de poussière s’élève et envahit la Grand’Rue. Le danger se rapproche, ça devient sérieux ; je conseille aux femmes de se réfugier dans la tranchée du jardin. J’envoie deux hommes dont un gendarme se rendre compte s’il n’y a pas de victimes dans la maison touchée. Ils partent au milieu du bruit des obus et des rafales de mitrailleuses des chars qui défilent sur le chemin qui surplombe l’Isère (à côté de Bellevue) et qui arrosent la ville de toutes leurs armes.
Cinq F.F.I. sont encore avec moi. J’en choisis trois, les meilleurs, de vieux camarades des Corps Francs (Marius Puzin, Izard et Roger Françon (hélas, je ne reverrai ce dernier que mort), et leur donne l’ordre de se rendre à Romans pour aller chercher le F;M. de notre groupe. A mon tour je vais aller me rendre compte des possibilités de défense. Une musette de grenades en bandoulière, une autre de chargeurs, la mitraillette sous le bras qui porte le brassard F.F.I., le casque bien en tête, je me hasarde dans les rues pavoisées comme jamais une ville en fête ne l’a été. Les Péageois avaient eu à cœur de fêter leur libération, mais tout à l’heure ce patriotisme va leur coûter cher. La fusillade s’est éloignée car les chars continuant leur roule sont au cœur de Romans. Les portes sont closes, à peine quelques curieux osent entrebâiller les volets et seuls, quelques téméraires, se hasardent dans la rue.
Je passe rue du Temple, à tous les carrefours des F .M. sont en position, mais on manque totalement d’armes lourdes. Je conseille aux curieux de regagner leur domicile, car si la bagarre se déclenche, il ne faudra pas être gêné par les civils. Plusieurs hommes me demandent des armes, mais malheureusement il n’est pas en mon pouvoir de leur en fournir.
Je me dirige vers la maison Charras (touchée par le premier obus) car les hommes n’en sont pas revenus. A ce moment, l’ordre est donné aux F.F.I. qui étaient rue du Temple de se retirer par la rue Mazagran. A regret, les hommes couchés le long des trottoirs se relèvent et se replient en ordre. Ils «ont interpellés par les civils et les femmes qui critiquent la manœuvre et leur reprochent de les abandonner. Pourtant il le faut (et on le verra plus tard) si on veut éviter un massacre inutile.
La fusillade se rapproche. A travers les jardins dont j’escalade murs et palissades, je me hâte vers la maison où je pense retrouver mes camarades. J’arrive dans le jardin de la maison Charras et suis obligé de m’abriter derrière un petit mur ; plus loin, dans une tranchée, toute la famille Charras est rassemblée ; j’apprends qu’il n’y a pas eu de victimes.
De véritables nappes de balles passent en sifflant au-dessus de nos têtes. Elles sont tirées par les chars qui passent dans la Grande Rue et qui font feu de toutes leurs pièces, criblant fenêtres et devantures. Les boches lancent également des grenades. Malgré l’insistance des gens occupant la tranchée, je refuse de prendre place parmi eux, ne voulant pas les faire fusiller dans le cas où nous serions découverts par les boches. Au « ralenti » les minutes s’écoulent. Nous ne savons rien de ce qui se passe. Il fait très chaud. Enfin les coups de feu se sont éloignés en direction de la Maladière où se trouve la Cie Daniel. A nouveau je regagne les jardins de la Gendarmerie. J’apprends qu’un gendarme a été blessé à la jambe par une balle de mitrailleuse. Avec mon aide, il peut marcher jusqu’à une maison voisine d’où je vais chercher les infirmiers de la Croix-Rouge. Un mot en passant sur l’héroïsme de Mlle Lupis, de Mme Détrat et de plusieurs dames de la Croix-Rouge dont je m’excuse de ne pas connaître les noms, des jeunes infirmières qui ont porté secours aux blessés et plus tard aux otages, malgré le réel danger qu’il y avait à circuler dans les rues. Les jours suivants j’ai vu de ces mêmes dames faire office de pompiers et déployer un courage au-dessus de leurs forces de femmes. Mon camarade étant dans de bonnes mains, je continue ma route et au passage constate que le bureau de tabac faisant le coin de la place Neuve et de la rue de la Gare a été touché par un obus. Par la brèche, je pénètre dans les appartements, pas de victimes ; je poursuis ma route. Avec de grandes précautions, j’aborde la Grande Rue pour regagner le Pont Vieux. Tout près de la boulangerie Verot, une large tache de sang. J’apprends que M. Chaumier a été tué à cet endroit. En vain, il a essayé de se dissimuler au passage des chars dans l’embrasure d’une porte et a été abattu à bout portant d’une rafale de mitrailleuse. Place du Pont Vieux, la pharmacie Mazade est en feu. Déjà les pompiers sont en action et on pense qu’ils vont se rendre facilement maîtres de l’incendie. J’entends le bruit d’une moto arrivant de Valence : rapidement je traverse la place et vais guetter le débouché des motocyclistes qui, je crois, sont des Allemands. Mon index se crispe sur la gâchette de ma mitraillette. En trombe, la moto débouche de la Grande Rue et in extremis je reconnais le capitaine Geo et son motocycliste Lapebie. Ils l’ont échappé belle ; à leur passage ils me crient : « Attention, les chars arrivent ! » Je donne connaissance de ces faits aux pompiers qui continueront malgré tout leur travail de sauvetage. Tout à l’heure, ils seront dispersés par les boches et leur matériel criblé de balles sera rendu inutilisable : l’incendie gagnera tout un quartier.
En compagnie de deux camarades, je décide de me porter à la rencontre des chars. Longeant les murs, nous nous dirigeons vers la Maladière. La ville semble morte, pourtant, entre les volets et les portes entrebâillés on aperçoit les visages anxieux des habitants qui guettent et attendent. Tout le monde a peur du pire. Les drapeaux en lambeaux pendent aux fenêtres et les habitants se hâtent de les faire disparaître pour ne pas exciter la colère des nazis. La terreur règne.
Vers le bout de la Grand’Rue, le bruit des chenilles se précise et il nous faut rapidement chercher refuge dans un couloir. De là nous verrons défiler à quelques pas de nous les chars lourds. Sur chacun d’eux, dépassant à mi-corps des portes des tourelles : un officier. Mes camarades m’empêchent de tirer sur eux au passage et ils ont raison, car la maison dans laquelle nous nous sommes réfugiés est sans issues et nous nous ferions inutilement massacrer. Plus tard je me rattraperai et j’aurai l’occasion de faire « un carton » sur une voiture transport de troupes sur laquelle sont juchés des soldats. Les chars patrouillent dans les rues. A plusieurs reprises, nous sommes obligés de chercher refuge dans des maisons. Les boches tirent même sur les chiens. De nouveaux incendies sont allumés. L’hôtel Eynard flambe. On ne peut porter secours et tout un pâté de maisons sera la proie des flammes. Peu après, le garage Riou est également incendié.
Les allemands s’installent et gardent les rues donnant accès à la ville. Seul le chemin de la Baratte n’est pas occupé et c’est par là que les Péageois en grand nombre quitteront la ville qui semble vouée à la destruction. Les boches qui ont installé plusieurs pièces anti chars aux carrefours tirent plusieurs obus rue Charles-Mossant. A l’intérieur d’une maison M. Lenain est tué, il y a des blessés. Pourtant, ils ont peur et ne sont pas fiers eux aussi. Dans la rue Neuve où l’incendie fait rage, un groupe de frigolins jette une grenade dans un couloir. La grenade rebondit et revient exploser dans la rue. Ils se dispersent rapidement en criant « terroristes » et la maison sera épargnée. Mais la nuit arrive. Des sentinelles boches sont disposées aux principaux carrefours et tirent sans discernement sur tout ce qui bouge. Us sont trop nombreux, trop bien armés ; pour moi,, le combat est fini. La rage au cœur je cache mes armes et vais dormir dans une maison où une âme charitable, bravant le danger que crée ma présence, m’a offert l’hospitalité.
Dans la nuit montent les flammes immenses de plusieurs quartiers en feu. Peu à peu les coups de feu qui n’ont cessé de crépiter s’espacent. La ville sombre dans une torpeur inquiète, mais très peu de Péageois dormiront cette nuit-là et le lendemain, à l’aube, beaucoup quitteront la ville pour aller se réfugier à la campagne. Pendant plusieurs jours les incendies feront rage ; heureusement, pas de vent. Au cours des jours suivants, je reviendrai fréquemment en ville et constaterai le dévouement inlassable des pompiers qui, aidés de quelques hommes et même de femmes, combattront les incendies et limiteront les dégâts dans la mesure de leurs faibles moyens. Il fallait être courageux pour braver la colère des nazis car, souvent, les boches tiraient dans la direction des sauveteurs.
Pendant plusieurs jours, la population angoissée vivra dans la terreur. Personne dans les rues. L’artère principale est parcourue par des colonnes et des voitures isolées, pourtant il faut manger. Des boulangers pressentis par M. Combe veulent bien faire du pain, et à la distribution, malgré la peur du boche, de longues queues s’allongent dans la rue ; il faut toute l’autorité de M. Combe pour que tout se passe dans l’ordre, car les allemands ne tolèrent que les femmes et en petit nombre dans les rues. Tout le monde se presse et rase les murs ; le moindre bruit de moteur précipite les gens dans les couloirs. Les canons tonnent, mais personne ne sait rien. Les nouvelles les plus invraisemblables circulent car, faute d’électricité, on ne peut prendre la radio. Les chars qui étaient au château de. la Parisière font des incursions sur la route de Pizançon, lâchent quelques obus dans les collines environnantes. On sent que les boches ne sont pas tranquilles. Malgré leur supériorité, ils ne crânent pas trop. Les jours passent. Les chars lourds partent et sont remplacés par des chars légers. Le mercredi, seules quelques voitures de liaison circulent. On sent la fin approcher, pourtant, toujours quelques obus tirés par on ne sait qui passent en sifflant au-dessus de la ville. Les boches se sont retirés côté Romans, il n’y a plus qu’une voiture légère dont les occupants ont l’air pour peu qu’on ne les prie, de vouloir se constituer prisonniers. Mais étant seul et sans armes, je les laisse filer. Tout à coup, un bruit formidable et un immense nuage de poussière (j’étais rue des Addoux) recouvre la ville : le Pont Neuf vient de sauter. C’est le signal du retour pour les habitants. Mais la ville est en deuil et on ne pavoise plus. La grande joie du 22 août est tombée.
**
VECU PAR LE PATRIOTE ARNAUD
13 h. 45 : des rafales de mitraillette viennent troubler la douceur de cette journée dominicale. Je prends mes armes et me précipite vers le Pont Neuf où je trouve un groupe de 4 à 5 jeunes armés. A peine en position, un cycliste nous apporte l’ordre de repli immédiat émanant de Thivollet. Il est 14 h. 10.
A ce moment là je n’ai pas encore vu les chars allemands que j’entends tirer en direction de Romans. Je reviens vers la Place Neuve où se trouvent deux camions en panne chargés d’armes abandonnées par les F.F.I. Aidés de deux camarades péageois, je transporte les armes chez moi. Nous prenons deux F.M. que nous mettons en position dans le jardin des tout petits. Nous restons ainsi vingt minutes, mais devant le bruit de la bataille et comprenant que nous avons à faire à des chars, pour éviter un massacre inutile, nous transportons le F.M. à mon domicile et partons vers un foyer d’incendie (pharmacie Mazade).
Rue Charles-Mossant, je m’arrête à la vue d’un char qui arbore un fanion, bleu blanc rouge. Nous hésitons une seconde, nous demandant s’il s’agit d’un américain ou d’un allemand, mais notre indécision est de courte durée, car une rafale est bientôt tirée dans notre direction. Nous prenons la fuite, allons au Café du Royannais où prévoyant l’arrivée imminente des boches, nous nous installons comme de paisibles joueurs de cartes. Le char s’arrête rue du Docteur Eynard et lâche des rafales de mitrailleuses chaque fois que nous voulons sortir. Bientôt un boche arrive et nous menace de son fusil. Nous levons les bras. Devant son attitude menaçante, je me mets à boiter, car il nous demande de le précéder vers le Café de France. Mes camarades plus jeunes sont brutalisés à coups de crosse. Je n’échappe à ces brutalités que par ma ruse.
Arrivés place Doumer, on nous pousse à l’intérieur du café : un boche est en train de mourir étendu à terre, un autre a une jambe broyée, dans un coin le sympathique M. Brechbühl arrêté place de l’Eglise quelques minutes auparavant, attend inquiet qu’il soit décidé de son sort, à droite et au fond de la pièce est un jeune F.F.I.
Dans l’arrière boutique les Allemands nous font ranger contre le mur ; deux boches armés de revolver nous tiennent en respect. Persuadés qu’on allait nous massacrer sur place, j’élève la voix à l’arrivée d’un sous-officier qui parlait français et déclare que nous ne sommes pas des terroristes, alors il m’interroge en faisant baisser les armes aux soldats qui nous gardent. Il me questionne sur le nombre de dissidents se trouvant dans la région, je lui réponds que je ne suis pas au courant ; il insiste : « 200, 250 ?» – « Beaucoup plus, il y en a partout ». Il cherche à se documenter sur les troupes américaines, la direction prise, les armes employées. Je vois que je l’intéresse et l’informe qu’ils sont passés très, très nombreux avec beaucoup de gros chars et de gros camions. Son visage s’allonge, il a l’air atterré par cette nouvelle qu’il s’empresse de communiquer à ses camarades.
**
BARBARES MEME POUR LES LEURS
A cet instant, un chirurgien allemand pénètre dans le café. Il se dirige vers le blessé et l’examine les deux mains dans les poches. Il fait le tour de la pièce, quitte sa vareuse, retrousse ses manches, prend une petite trousse en cuir, se met à genoux à côté du blessé et se prépare à lui couper la jambe au milieu du tibia. Il saisit la cheville de la main gauche et se met au travail armé d’un bistouri. Le blessé qui n’est pas endormi pousse des hurlements de douleur, mais le major le semonce vertement. Malgré l’affreuse douleur qu’il manifeste en se tordant, le blessé allemand ne dit plus rien. Le toubib boche tire à coups secs sur la jambe et scie de toutes ses forces. La jambe cède et le bourreau jette le membre au milieu de la place du Vieux Pont. Il enveloppe ensuite le moignon avec un torchon de cuisine et le blessé est chargé sur un char avec son camarade qui, à ses côtés, a fini de vivre.
Comment voudriez-vous que de tels hommes soient humains avec leurs ennemis ?
**
LE MARTYRE D’UN JEUNE F.F.I. ET LA MORT DE 3 PATRIOTES
Toujours dans le cadre inoubliable du café de France de Bourg-de-Péage, laissons M. Arnaud reprendre son récit. « Après cet « intermède », l’officier allemand me montre le jeune F.F.I. me demandant ce que signifie son brassard. « Croix Rouge » dis-je. Mais il s’indigne, et me montrant la croix de Lorraine, réplique : « Non, terroriste ». Je comprends que le sort du jeune patriote est désespéré.
II est interrogé, on le bat, il refuse cependant de donner les noms de ses camarades. Alors les boches s’emparent d’une queue de billard et la cassent sur sa tête, il fait montre d’un courage héroïque, pas un cri. Fous furieux, les boches lui labourent alors le visage avec les esquilles. Le sang coule. A coups de chaise encore, on essaye de faire parler ce pauvre martyr. Mais rien, pas même une plainte.
Mais voilà que des soldats allemands amènent encore trois F.F.I. Il s’agit de l’abbé Georges Magnet, curé de la Bâtie-Rolland, très actif dans la dissidence, du patriote Marie-Joseph Gignoux de Tassin la Demi-Lune et d’un inconnu encore non identifié à ce jour. Ils essaient de se faire passer pour des soldats parachutés dans la région le 12 mars 44. L’officier dit : « Vous beaucoup grande langue, vous beaucoup coûter cher ».
A ce moment, les boches s’aperçoivent de notre présence qu’ils avaient oubliée, ils nous poussent dans la rue, puis dans le couloir de M. Balthazar. Au même instant, nous entendons deux coups de revolver, nous pensons qu’ils sont destinés au jeune F.F.I. martyr, c’est un soulagement pour nous à l’idée qu’il ne souffre plus. Nous rejoignons trente personnes dans la cave de l’immeuble et vers une heure du matin, je suis désigné avec quatre camarades comme otages et prévenus que nous serons fusillés si un soldat allemand est tué.
Dans la soirée également, on retrouvait contre le mur d’un immeuble de la rue des Adoux les corps de l’abbé Magnet, de Gignoux et de leur camarade inconnu fusillés par les barbares nazis.
Le corps du jeune F.F.I. n’a jamais été retrouvé. On pense que les allemands l’ont jeté dans un brasier afin de faire disparaître les traces de leur horrible crime.
**
DEUX MORTS AU PONT NEUF
Deux braves, deux vaillants F.F.I. trouvent une mort héroïque ce 27 août dans la rue du Nouveau Pont. Gabriel Ginot et Henri Jacquet, marié, père de famille, attendent l’ennemi avec quelques camarades. Leur défense est héroïque, mais hélas, ce sont des tanks qui arrivent pour combattre et tirant de tout leur courage sur un ennemi blindé, ils s’écroulent sous les balles allemandes.
Une plaque commémorative rappellera aux Péageois le sacrifice de ces courageux soldats de la Résistance.
**
A LA MALADIERE
Extrait du journal du groupe (secrétaire R. Millou)
Dimanche 27 août, le groupe est toujours en position à la Maladière.
Préparation du dîner chez Fabre. Il est porté sur la position à 12 h. 45 en voiture par Millou et le chauffeur Astier.
Dîner sur la position, puis retour de la voiture transportant les gamelles vides avec le chauffeur Astier, Millou, Chochillon.
En passant place Maurice-Faure à Romans, nous percevons des rafales de mitraillettes qui ont l’air de partir de la rue de l’Armillerie. Nous poursuivons la route jusqu’en haut de la côte des Cordeliers. Il est 13 h. 45. Là il est impossible d’aller plus loin ; les blindés allemands arrivés par la route de Tain sont sur la Place d’Armes d’où ils tirent sur tout ce qu’ils rencontrent. Une décision est prise ; faire demi tour et alerter le poste de la Maladière. Arrêt à l’Hôtel Eynard à Bourg-de-Péage où nous avertissons la Cie Bourgeois ainsi qu’une voiture montée par deux Américains. Arrivés sur la position, il est 14 heures, nous alertons le chef Piron qui part aussitôt en reconnaissance accompagné du docteur Long et du chauffeur Astier. Le lieutenant Pérée reste parmi nous et ordonne le repli dans la direction de Pizançon dès la chute des premiers obus qui a lieu vers 14 h. 15.
Repli sous une pluie d’obus et de balles.
Nous atteignons la Bourne où, à l’abri de la butte de terre nous descendons le canal à la suite les uns des autres. Les deux américains sont parmi nous. Le lieutenant Pérée en queue.
Mais les blindés allemands qui sont également arrivés par la route de Bésayes (leurs blindés et voitures avec drapeau français) traversent le canal de la Bourne et remontent sur nous par la route qui longe le canal. Un blindé s’arrête sur le pont à 50 mètres de nous et tire sur nous au canon. Le F.M. crache également. Le sous-lieutenant américain est tué, un homme atteint par les obus est déchiqueté. La Bourne se teinte en rouge. Impossible de parvenir au pont suivant qui est à 50 mètres. Certains hommes traversent à la nage le canal sous une pluie de feu. D’autres restent dans la Bourne ; ils sont touchés et partent au fil de l’eau. Le sergent Vigno blessé assez sérieusement se voit contraint d’abandonner son F.M. dans le canal. Quelques hommes n’ont plus le temps matériel de traverser et restent dans l’eau. Leur tête seule émerge ; ils se dissimulent sous de maigres branchages. Ceux qui ont pu traverser restent à côté du canal, dissimulés derrière la butte. De l’autre côté du ruisseau, les blindés allemands passent ; ils sont 18. Nous restons une heure environ dans cette position au milieu de débris humains (une tête et un bras tombent à nos côtés).
Utelle père et fils partent à découvert en direction d’un champ de topinambours. Ils sont abattus en chemin.
Les blindés sont passés. En rampant, nous gagnons le large jusqu’à une ferme où le sergent Vigno est soigné. Le lieutenant Pérée lui fait un pansement provisoire et part ainsi que Mironi et Mazeyrat dans la direction du bois des Naix.
Nous nous éloignons des fermes pour leur éviter des représailles. Vigno se cache dans les vignes.
Après avoir enterré nos armes et les papiers de la compagnie, nous partons Tesi et moi à 500 mètres plus loin où nous nous cachons dans un champ de maïs. Nous grelottons, trempés jusqu’aux os par le bain forcé. Nous sommes allongés dans la boue. Nous sommes à 100 mètres de la route de Bésayes d’où arrivent encore les blindés allemands. De l’autre côté de la Bourne, nous voyons brûler les unes après les autres, les fermes Juven, Cluze et d’autres encore, car une voiture allemande est arrêtée à côté de la Bourne. Ils incendient et mitraillent tout ce qui bouge.
Nous restons ainsi deux heures dans ce champ, puis nous revenons à la ferme où nous avions laissé le blessé.
M. Juven nous apprend que Morin blessé est resté de l’autre côté de la Bourne. Tentative avec Tesi pour aller le chercher. Nous nous faisons mitrailler et devons l’abandonner. Le sergent Vigno revient vers nous. Nous décidons tous les trois de partir vers Chatuzange-le-Goubet. Nous rampons assez longtemps. Chaque fois que nous sommes à découvert, les balles nous sifflent aux oreilles. Nous atteignons Chatuzange à la tombée de la nuit.
Le lundi, à la pointe du jour, nous, partons vers Rochefort-Sam-son où une infirmière à qui nous confions le blessé le soigne en attendant du secours de l’hôpital de St-Maurice-d’Hostun que nous avons fait prévenir. Nous retrouvons Vigno Pierre qui est sain et sauf, passons la journée et la nuit à Rochefort-Samson.
Le mardi, nous tentons de nous rapprocher de Bourg-de-Péage, à la recherche des rescapés de la Maladière. Nous apprenons qu’au Pont des Seigneurs le chef Piron et le lieutenant Pérée ont été légèrement blessés par des sentinelles allemandes. Nous retrouvons Pouzin et tout son groupe qu’il a ramené intact à travers les lignes allemandes. Nous assistons aux incendies qui s’allument sur Romans et Bourg-de-Péage.
**
EXTRAIT DU JOURNAL DU LIEUTENANT P…J… (Groupe Daniel)
…27 Août 44…Maladière.
Vers 14 heures, des bruits de moteurs et des crépitements de mitrailleuses se font entendre dans la direction du Relais, c’est-à-dire derrière nos positions. Le chef me laisse le commandement du groupe pour aller lui-même en reconnaissance. Il est accompagné du docteur et de l’agent de liaison A.. M.. Ce dernier est renvoyé aussitôt pour nous dire que des chars boches arrivent. Le chef et le docteur se trouvent séparés du groupe par un, puis deux chars.
Quatre blindés apparaissent, en tirant, à 80 mètres de nous, en A. Notre F.M. 4 tire aussi. Je me précipite jusqu’à la route d’Alixan. Coups de sifflet. Ordre de repli et de dispersion vers Pizançon ; comme cela était prévu en cas d’attaque par des chars. Les boches ajustent leurs tirs à la mitrailleuse et au canon. Le groupe du F.M. 4 ne peut pas traverser la route d’Alixan. Il se replie) dans les champs entre les deux routes. Les groupes des F.M. 3, 2 et 1 et les voltigeurs partent sous la mitraille vers le pont. Je suis en queue et je dirige avec nous, deux américains qui viennent d’abandonner leur jeep, trop belle évidemment pour l’ennemi si proche. Traversée du canal de la Bourne dans l’eau ou par le pont. Entre 1 et le pont, nous sommes encore une demi douzaine qui n’avons plus le temps de passer, car d’autres chars arrivent en B et tirent. Nous entrons dans l’eau jusqu’au nez ; nos armes sont devant nous. Rafale le long de la berge. Les branches des arbustes nous tombent sur la tête. L’un des deux américains visible de la route est déchiqueté à 10 mètres de moi par un obus en pleine poitrine. Les blindés passent à deux mètres de nous. Le cinquième s’arrête juste devant l’emplacement du F.M. I où je me trouve. Les secondes sont très longues. Les boches discutent, mais ne descendent pas. L’engin repart. D’autres suivent encore. Dès qu’ils sont un peu plus loin, nous sortons de là. Au pont nous trouvons le sergent V… F… immobile et les yeux grands ouverts. Il a cinq blessures, à la tète au bras et à l’épaule. Nous l’emmenons dans une ferme où nous le pansons. Il est évacué ensuite par notre camarade M…. Nous retrouvons le chef et le docteur qui ont réussi à se dégager. Une quinzaine des nôtres au moins sont vivants et dispersés dans la campagne. Mais les autres ? Après cette avalanche de ferraille nazie (une vingtaine de chars qui occupent maintenant toute la zone), quelles seraient nos pertes ? Nous rencontrons le fermier J…. Ses yeux sont pleins de larmes. Là-bas deux fermes brûlent.
**
TRAGIQUE BILAN
Cinq morts. Sept blessés.
Le père et le fils Utelle, deux volontaires courageux et dévoués tués à côté l’un de l’autre par une rafale de mitrailleuse. t
Le tireur du F. M. 2 ; Joyeux Claude voulant transporter son camarade M…. A…. très grièvement blessé à la tête ; lâchement assassiné par les boches pendant que le blessé était dévalisé, repoussé à coup de pieds et laissé pour mort sur le terrain.
L’agent de liaison, Astier Marias, toujours dévoué, tué dans la cour du P. C. où il s’était réfugié.
Le voltigeur Burlet Jean, tout jeune volontaire, tué dès le début de l’action.
Ne laissons jamais s’estomper leur souvenir. Ils ont fait le sacrifice de leur vie pour un idéal, celui de la liberté.
**
29 AOUT 1944
Aujourd’hui, encore une petite reconnaissance à trois (le chef, le toubib et moi) en direction de la Maladière. Un revolver chacun nous longeons tranquillement le canal de la Bourne. Cela a tout à fait l’allure d’une simple promenade jusqu’au Pont des Seigneurs où nous nous trouvons tout à coup à une dizaine de mètres et en contre bas d’un poste de surveillance boche ? Avec les « Feldgrau » se trouvent une demi-douzaine de civils, femmes et enfants. Impossibilité de tirer. Un grand boche blond nous aperçoit « Achtung ! Achtung ! » Un autre se précipite sur sa mitraillette. Nous sommes cuits. Un seul abri possible. Sous le pont. Descente du remblais à découvert sur une trentaine de mètres pendant qu’on nous vide un chargeur de mitraillette dessus. Le chef fait du rase-mottes ; le toubib une sorte de vol plané et moi une descente en vrille. Atterrissage sous le pont qu’une arme automatique boche installée plus loin se met à arroser copieusement. De l’autre côté nous sommes enfin à couvert. Repli stratégique, progression à front retourné.
Une balle de mitraillette a traversé la hanche droite du chef, qui marche de travers, et une autre est venue me faire un joli petit trou dans la jambe gauche. Le toubib va pouvoir exercer son art.
**
MALADIERE……. 27 AOUT
(mon Journal)
Je m’excuse de m’attarder tout particulièrement sur l’engagement de la Maladière, mais 5 morts et 7 blessés, voilà un bilan suffisamment éloquent pour que je puisse entrer par le détail dans le déroulement des opérations.
On a appris que le jeune André Morin avait été blessé très gravement au cours de cette attaque subite des boches. Les heures douloureuses qu’il a vécues et les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été trouvé méritent ces lignes.
Morin est en position à la ferme Juven, avec 3 camarades, derrière des bottes de paille formant blocos. Ils attendaient les boches par Valence et ceux-ci arrivent par Châteauneuf, ils les ont donc dans le dos.
A 14 heures, ils voient les chars qui arrivent du relais, les fusils mitrailleurs tirent immédiatement sur les boches qui les suivent, mais les blindés braquent leurs pièces sur les bottes de paille.
Repli inévitable sous une pluie d’obus. André Morin est touché.
Lorsqu’il revient à lui, il s’aperçoit qu’il a une terrible blessure à la tête, le cerveau a été atteint, il a un côté paralysé.
Morin appelle. Son camarade, Pierre Joyeux, qui s’est replié jusqu’à la ferme Juven vient le secourir. Hélas, un char allemand stoppe derrière eux, trois boches en descendent et l’un d’eux les met en joue. P. Joyeux s’avance, il parle bien l’allemand. La conversation échangée restera inconnue, Morin est trop loin pour l’entendre et Joyeux payera tout à l’heure de sa vie son courage.
Joyeux et les hoches reviennent vers le blessé qui, porteur d’armes allemandes est désarmé, frappé à coups de pieds dans le visage, puis deux balles de revolver dans le dos destinées à l’achever le transpercent, mais la mort ne veut pas de lui.
Joyeux est emmené à quelques 50 mètres et Morin pantelant entend deux coups de feu : Joyeux a été abattu par les bourreaux.
Et notre blessé se traîne vers le bord de la route. Après 26 heures, il entend près de lui des pas qu’il croit être ceux de paysans, il appelle ; mais terreur, ce sont encore des Allemands : un lieutenant et deux hommes. Le lieutenant tient dans ses bras un chat qu’il caresse gentiment.
« Tu es terroriste ? » dit-il à Morin. Et le blessé à bout de forces, raconte péniblement sa triste histoire. Le regard de l’officier l’encourage et il dit comment il a été brutalisé. Après quoi l’Allemand murmure : « Et dire que je fais la guerre avec des gens pareils ! »
Morin réclame à boire, il lui tend sa gourde ; envoie les deux hommes chercher du secours à la ferme Salique ; charge lui-même le blessé sur la voiture que ramènent deux paysans, le fait conduire à la ferme où lui sont donnés les premiers soins, et il signe un laissez passer pour que les paysans puissent circuler librement en ville et accompagner Morin à l’hôpital de Romans.
En partant l’officier tend la main au blessé, et à ce sujet, André Morin vous dira aujourd’hui, après un an de souffrances et pas encore complètement valide : « Je ne sais si c’est bien ou mal, mais voyez-vous je lui ai embrassé les mains… et je vous assure qu’il avait des larmes dans les yeux ».
Un humain se trouvait parmi les barbares, André Morin lui doit la vie.
Une fleur dans la boue attire toujours le regard.
On apprend aussi que le lieutenant Berthet, dit Molaire, de St-Jean-en-Royans et appartenant à la Compagnie Fayard, a été tué en cette tragique journée du 27 août sur la route d’Alixan, dans ce même secteur de la Maladière.
**
VU DU COTE SUD
(journal A. Chaloin)
27 Août. 14 heures. Je vois arriver 18 tanks boches qui viennent de la direction de Valence à travers champs ; sur leur passage ils incendient une meule de paille dans la propriété de M. Blachon, aux Coppes. Puis les exploitations agricoles de MM. Juven, Cluze, Mathon au quartier des Barons. Au Tépiers, Mme Rousset est tuée d’une balle, sur sa voiture hippomobile, au moment où elle évacue la ferme. Mme Blache est tuée au pont de l’Ardoise, sur le canal de la Bourne, au moment où j’essaie vainement de regrouper les Sénégalais qui fuient de toute part. Certains sont tellement affolés, que ne voyant pas le pont ils traversent le canal à la nage.
Un peu plus tard, je suis repéré par une patrouille de tanks qui m’envoie quelques bandes de mitrailleuse, qui heureusement me manquent. Peu après la ferme Barret, aux Seyvons, est en flammes, et on apprend que l’habitation de M. Bert, de l’Ardoise a été saccagée et pillée.
**
OU L’ON TROUVE L’ŒUVRE DES TRAITRES
(Mon journal)
Un petit fait maintenant pour prouver que les boches qui réoccupent la ville sont parfois guidés par des Français, hélas.
Le lundi 28 Août, au 13 de la rue de la Ferme, vers 14 heures, deux officiers allemands et trois soldats pénètrent dans l’immeuble. L’un d’eux semble chercher quelqu’un. Il déchiffre sur chaque porte le nom du propriétaire et bientôt satisfait, s’arrête devant l’appartement de la famille Caillet. Le petit jeune homme était agent de liaison à la Dissidence. Il n’est évidemment pas là, pas plus que sa famille. La porte est enfoncée, les boches font évacuer les autres locataires et des grenades sont jetées dans l’appartement. Parmi les destructions causées ce jour-là, cet incident ne comporte pas un intérêt particulier, mais il prouve, et voilà sa force, que des Français furent assez lâches pour dénoncer un jeune patriote. A ce sujet, le témoin est affirmatif : l’officier allemand avait dans les doigts une feuille de papier sur laquelle était écrit : Caillet Marcel, 13, rue de la Ferme.
La Milice ou quelque ignoble délateur avait commis ce crime.
Les craintes de Victor Boiron s’étaient bien réalisées. Le bilan de cette journée de retour des hordes nazies se chiffre par des morts militaires et civils, des blessés, des incendies, des destructions, des souffrances, des angoisses, des misères. On pourrait sans arrêt donner récits et récits tous semblables à quelque chose près. J’ai seulement voulu, par certains, essayer de résumer l’ensemble de cette journée tragique.
Partout, ce fut le même affolement, la même terreur, la même destruction. Partout dans notre cité il y eut des sacrifices, des dévouements cachés et qui ont, de par leur simplicité, fait de ce jour, -le jour de tous les romanais, le jour de la rage au cœur, de la souffrance et de l’union dans le malheur.
**
LUNDI 28 AOUT
(Mon journal)
Les tanks continuent à passer sans arrêt. Quelques rares romanais longeant les murs essaient d’évacuer dans la campagne. Les équipes d’urgence circulent avec les brassards et les drapeaux Croix-Rouge. Les rues, les places sont jonchées de débris d’arbres, de tuiles, d’armements. A l’angle d’une rue, une belle voiture noire arrêtée, pneus crevés est devenue un tombeau. Un de nos F. F. I. y gît et nul ne peut encore le toucher. De plusieurs points, les brancardiers ramènent des blessés ; les morts sont nombreux.
Le canon tonne, les avions américains survolent sans cesse la ville. Sur le boulevard une batterie de D. C. A. fait un bruit d’enfer. Les boches pillent. Bourg-de-Péage brûle, partout l’incendie fait rage, les pompiers se dépensent avec un courage et une énergie dignes d’éloges.
Au café Glacier nos otages, auxquels se sont joints ceux du faubourg Clérieux, se morfondent, inquiets… Un grand nombre d’entre eux ont été libérés, de courageuses personnes étant intervenues auprès du major allemand. Les électriciens sont relâchés pour travailler à nous rendre la lumière. Le soir l’électricité revient. Toute la nuit les tanks passent, les boches sont à bout. Certains de leurs blindés sont équipés au gazogène et montent poussivement la côte des Cordeliers. Le corps de trois jeunes patriotes de chez nous : Théo Besson, Robert Sauvan et Jean Vachon de la Compagnie Géo tués au Pas de la Balme doivent être inhumés au cimetière de Romans. Il semble que l’ennemi se soit particulièrement acharné sur ces braves, car c’est sous la mitraille qu’un fourgon les conduit au champ de repos.
Au crépuscule, en service commandé et sous l’uniforme, Simone Abba, nièce de Pierre Sémard, secrétaire du P. C. régional des F. T. P. F., tombe, dans la région romanaise, sous le feu des autos mitrailleuses boches.
**
MARDI 29 AOUT
(Mon journal)
A 6 heures, une explosion formidable : les boches ont fait sauter le Vieux Pont. Quelques Romanais affolés essaient d’évacuer. C’est une journée de grosse inquiétude. Le collège flambe, les explosions se succèdent et les tanks venant alors du nouveau pont roulent toujours en direction de Peyrins, Beaurepaire. Dans l’après-midi les bombardements reprennent. Les batteries américaines installées à St-Paul tirent sur la ville et toute la nuit les obus s’abattront sur notre cité. Arrivées, départs font un bruit assourdissant et pendant ce temps l’aviation est active. C’est une nuit de terreur et d’angoisse.
**
MERCREDI 30 AOUT
(Mon journal)
De bonne heure les Allemands viennent chercher les armes dissidentes restées à l’Eden. A 8 heures, dans un fracas épouvantable, le Pont Neuf saute, la charge était énorme, il ne reste plus rien du Pont. Nous prenons espoir, les Américains sont aux portes de la ville. On sent une certaine inquiétude chez les frigolins. A 13 heures, le Commandant Coche pénètre en ville pour préparer l’entrée des F. F. I. Les Allemands, harcelés par les Américains, n’ont pu à temps faire sauter le pont du Barrage et, de Pizançon, comme de Saint-Paul les Américains entrent dans la cité pendant que les boches fuient vers le nord.
A 15 heures 35, les premières voitures blindées américaines sont reçues à l’Hôtel de Ville par M. Chardon, puis les F.F.I. défilent.
Inquiets et meurtris par l’épreuve qui fut dure pour tous, les romanais restent froids. Pas d’applaudissements, pas d’enthousiasme, le canon tonne toujours. Bientôt l’infanterie américaine en position de combat s’infiltre dans la ville longeant les murs, cherchant les boches, c’est trop tard, ils ont fui.
Il faudra cependant être prudent car, dans leur retraite, les fuyards nous gratifient de quelques obus, les derniers, fort heureusement. Ils ne feront pas de victimes.
Point d’eau, point de lumière, point de ravitaillement. On s’organise, mais c’est la queue interminable à la fontaine, au bureau du rationnement où sont distribués bons de viande et de pain. La Croix Rouge est d’un grand secours.
Plus de boches, c’est l’essentiel.
Et voilà que nous arrive l’écho des plus tristes nouvelles : les noms des morts dissidents qui se sont battus comme des forcenés contre des blindés, ceux de nos civils, innocentes victimes d’une guerre injuste.
Victor Boiron et son compagnon de combat, le capitaine Paquebot, avaient été tués le lundi 28 août par le feu d’un blindé boche.
Et c’est sur ces visions de mort que se termine cette journée de libération définitive.
Dans la nuit l’aviation fut très active, elle a pilonné sans arrêt les troupes ennemies en retraite.
La bataille s’éloignait…
**
JEUDI 31 AOUT
(Mon journal)
Les Valentinois ont été libérés dans la nuit des 9.000 allemands que les batailles de Montélimar, Loriol et Crest avaient obligés de battre en retraite.
Des voitures romanaises qui avaient déjà à plusieurs reprises tenté d’aller aux nouvelles ont, cette fois, pénétré jusque au cœur de la capitale drômoise.
Les Valentinois ont vécu depuis une semaine dans les caves. Le mardi 29 août fut marqué par l’explosion, à 13 h. 30, de cinq wagons de nitroglycérine détruits par les allemands.
15 morts, 200 blessés, tout un quartier détruit.
Puis ce fut le bombardement par l’artillerie américaine. Quelques obus çà et là et l’anxiété, l’inquiétude du lendemain.
Les Romanais ont trouvé Valence pavoisée…
*****************************
Et la vie reprend…
VERS LA VICTOIRE
(Mon journal)
1e Septembre. – A Bourg-de-Péage, exécution contre le mur du cimetière de Daniel Audigier, milicien. Au moment où l’officier va commander le feu, il tourne la tête vers le peloton en faisant le salut hitlérien.
3 Septembre. – Le Colonel Legrand du Comité départemental de Libération nomme le Commandant Phi-Phi chef des F. F. I. du secteur Drôme-Nord.
– Le ravitaillement municipal s’installe dans les locaux du Repas Economique et nourrit un nombre important de romanais.
4 Septembre. – Jour férié, fête de l’Indépendance Day.
5 Septembre. – Prise d’armes en présence du Colonel Legrand. La brise matinale déploie les plis des drapeaux rentrés hâtivement lors de la subite attaque du dimanche. Certains, fanés et déchirés, témoignent des jours pénibles vécus.
7 Septembre. – Retour de M. Blanchard, dit Alex. Arrêté par la Milice le 23 mai 44 et délivré à la prison St-Joseph par la Libération de Lyon.
– Deux allemands sont faits prisonniers dans la ferme Martin, quartier des Garennes, à Bourg-de-Péage.
8 Septembre. – Prise d’armes par le 11e Cuirassier, commandé par le Capitaine Thivollet. Nombreux romanais sont à l’honneur. La population acclame nos F. F. I. qui vont partir pour le front d’Alsace.
Au cours de la semaine qui vient de suivre la Libération, l’épuration a été très active. Les détenus d’abord envoyés à la caserne Servan ont été installés à l’Ecole Maternelle de la rue St-Just. Plus tard, ils seront dirigés vers l’Avenue Duchesne. Après étude des dossiers par le Comité d’Epuration, certains ont été relâchés et les autres ont été jugés par les différentes cours se rapportant à leurs cas.
**
11 Septembre.
DES FEMMES ACCABLEES
(Mon journal)
On vient d’apprendre en ville la mort de Louis Caillet et de son fils Pierre, tués à St-Guillaume.
Quelles femmes accablées, celles qui se voient à la fois veuve et mère inconsolables. Celles qui donnant un mari croyaient avoir donné tout leur bien à la France et qui se voient aussi arracher un fils, objet de leur affection, de leur tendresse, un enfant élevé au prix de souffrances et de sacrifices. Voilà le comble pour une femme. Il n’est pas de mot, il n’est pas de sollicitude qui puissent être exprimés pour adoucir la douleur de ces femmes martyres. Il semble même qu’une consolation serait comme une offense. Devant semblable désespoir, il semble qu’on ne puisse que rester muet et s’incliner respectueusement.
Mme Caillet, de la Cité, après avoir connu les douceurs de la vie familiale, se trouve seule…. Absolument seule. Le père, Louis Caillet, 41 ans, et son fils Pierre, 19 ans, poussés par un même désir de servir et d’anéantir l’envahisseur, sont partis tous les deux le 9 juin au Vercors. Ils ont combattu à St-Nizier. Ils ont, côte à côte, été tués à St-Guillaume (Isère), le 25 Juillet. Dans un foyer ou régnait le bonheur, la désolation est maîtresse. Une femme meurtrie dans ses plus profondes affections est effondrée par l’épreuve.
Mme Utelle a perdu en ce même dimanche du 27 août, son époux et son fils.
Ernest Utelle était parti pour combattre. Partout il avait demandé des armes. Il voulait libérer son sol, prendre une part active dans la Dissidence. Avec son jeune fils, côte à côte ils ont combattu les allemands qui, sur des blindés, allaient reprendre notre ville. Ils- avaient le courage, la volonté de vaincre, mais hélas, que pouvaient faire leurs fusils sur le blindé qui crachait le feu ?
Ernest Utelle et son fils, toujours côte à côte, tombèrent sous les balles allemandes.
Leurs corps reposent sur la terre péageoise qu’ils auraient tant aimé voir à nouveau libérée.
Mme Marin Cheval avait un tout jeune fils de 17 ans. L’année avant, il avait été pris dans une rafle effectuée dans les rues de Romans. Il fut envoyé au fort Montluc où il avait fait une détention d’un mois. Depuis il avait nourri une haine féroce pour les Allemands. Aussi les supplications d’une mère inquiète ne purent le convaincre de ne pas partir au Vercors. Sans permission il quitta la maison paternelle pour hélas, ne plus y revenir. Il était tué par les Allemands le 29 juillet, à Malleval… Un mois après une nouvelle épreuve devait accabler cette mère inconsolable. Le père, Marin Cheval, retraité, était tué à Romans à bout portant le 29 août. Le malheur s’acharnait.
Deux autres patriotes, Emile Clerc et son jeune fils Robert avaient aussi quitté les douceurs de la vie familiale pour gagner le maquis du Vercors. Côte à côte ils combattirent, côte à côte ils furent pris par les Allemands et fusillés dans le petit village de St-Martin-en-Vercors. Là, encore, une pauvre femme reste seule, sans famille, désorientée, ne vivant plus que du souvenir des deux disparus.
A Bourg-de-Péage, c’est Mme Monteillet qui donne trois martyrs à la dissidence : son mari, 47 ans, son fils Maurice, 21 ans, et son jeune gendre, Louis Chovet. Tous trois semblent avoir joué de malheur. Le père est tué dans une rencontre entre maquisards et allemands. Le jeune Maurice, agent de liaison du Commandant Abel, meurt des suites d’une blessure non soignée, alors que traqué dans les bois il reste de longs jours sans boire, ni manger. Louis Chovet, arrêté par les allemands est fusillé alors qu’il allait être sauvé. Dans cette atmosphère familiale ou cinq êtres s’aimaient, deux femmes aujourd’hui vivent de souvenirs.
Toutes ces femmes romanaises si cruellement affligées ont vers elles toute la compassion affectueuse des épouses et des mères.
**
UNE BELLE FIGURE DE FRANÇAIS DISPARAIT
(Mon Journal)
Le 9 Octobre : Une bien douloureuse nouvelle nous arrive de l’Hôpital : l’Aumônier vient de mourir. Je l’avais vu la semaine auparavant, il se remettait bien d’une opération fréquente à son âge. Cette mort frappe cruellement tous les dissidents… car en l’abbé Richard, Romans perd un ardent patriote, un dissident de toujours, celui qui, dans son livre « Le Fléau de l’Europe » écrivait en 1936 :
« Un fantôme se promène à travers l’Europe, à travers le monde entier.
Il n’est pas un seul pays dans lequel on ne puisse relever ses traces, où il n’ait tendu ses réseaux secrets ; pas un seul état qui ne soit menacé par lui directement ou de manière indirecte…
Ce fantôme, c’est celui de l’espionnage allemand, c’est celui de la propagande pangermaniste.
En réalité, depuis 1933, l’Allemagne est en état de guerre avec toutes les organisations qu’elle considère comme ses adversaires présents ou ses victimes futures. Elle mène contre eux une guerre, sans doute souterraine et – pour autant qu’une telle expression soit de mise en pareille circonstance, – spirituelle mais qui n’en est pas moins une guerre véritable.
Cette guerre larvée n’est d’ailleurs que la préparation, que l’introduction à la guerre de conquête et de destruction qui va suivre.
Or de nombreux Français semblent encore prêts à se laisser tromper par les discours pacifiques du Führer.
Mais nous avons le droit et le devoir d’être vigilants et de montrer à F Allemagne que la France connaît le sens et les buts de cette politique allemande … »
On voit par ces quelques phrases prises çà et là, combien il avait des raisons d’être recherché, de vivre sous un nom d’emprunt, tout en continuant son œuvre dissidente.
Un glas a sonné dans le cœur de tous ceux qui ont approché de près et même de loin notre bon aumônier de l’Hôpital.
Ce n’est pas seulement à l’homme supérieurement intelligent, lettré, au regard droit, au bon sourire et débordant d’activité malgré ses 70 ans qu’il faut rendre hommage, mais aussi au grand Français que fut l’aumônier Richard, de son véritable nom Nicolas Ridinger.
Alsacien, professeur de théologie, il a toujours lutté contre l’Allemagne. Laissant déborder très ouvertement ses sentiments de Français, il devait être un de ceux que le nazisme voulait arrêter dans son effort de propagande.
Fondateur et Directeur du « Messager de Colmar », son bureau et son appartement furent placés sous scellés en juin 40.
Alors l’abbé Ridinger se replie à Paris, mais regagne Calmar une fois par mois pour travailler clandestinement à la cause Française. Recherché par la Gestapo il se replie successivement à Bayonne et Alger où il s’occupe de l’accueil et de l’aide aux réfugiés alsaciens et lorrains. Il revient à Marseille où, recherché à nouveau, il part pour Romans sous le nom de bataille de Richard.
Aumônier de l’hôpital, sa connaissance de l’âme allemande et sa foi en l’avenir de la patrie, en font un auxiliaire ardent de la dissidence.
Son intelligence et sa mesure en toutes choses en faisaient un conseiller. En bon prêtre, il se penchait sur toutes les misères, en bon Français, il nourrissait un sentiment affectueux à l’égard de ceux qui n’avaient jamais cessé de combattre pour délivrer la Patrie.
C’est lui qui, malgré la botte allemande, a fait de pieuses funérailles aux quatre dissidents torturés par les Boches au Martinet, et combien en a-t-il enterré depuis, malgré la défense, déposant la croix de Lorraine sur les tertres.
Il est mort sans voir se réaliser son vœu : revoir son cher Colmar, reprendre son journal, mais il a cependant vu parcourir par les libérateurs un grand chemin pour la délivrance de la France.
Dans sa chapelle où il repose en ce lundi 9 octobre, le fanion Yves Péron est étendu sur son cercueil. C’est le fanion qu’il a béni avant le départ pour le Vercors, c’est ce fanion qui a présidé aux funérailles d’un petit gars tué là-haut.
Et demain, au grand étonnement de tous ceux qui ignorent, l’abbé Richard qui pour la plupart des Romanais était un modeste prêtre d’hôpital, sera conduit au champ du repos dans un cercueil recouvert du drap tricolore.
**
(Mon journal)
11 Octobre. – Le couvre-feu est supprimé sur l’ensemble du département.
Et la vie continue sans événements saillants dans la cité. De Belfort toutefois nous arrive la nouvelle de la mort de nombreux romanais tués au cours des combats menés afin de mettre définitivement hors de France les envahisseurs nazis.
Le 24 décembre, alors qu’on semble goûter cette soirée de Noël autrement calme que la dernière où la gestapo veillait dans nos murs, voilà que vers 10 h. 30, sans arrêt, des avions passent dans le ciel. L’offensive allemande n’est pas contenue en Alsace, on craint quelque malheur. La police est mise en alerte, les gendarmeries, les F.F.I., on craint des parachutages. A Vassieux les avions contournent toutes les cimes, la population est affolée. Rien de grave, ce n’était qu’une alerte, mais les grands oiseaux de mort avaient assombri cette nuit de Noël.
Et voilà que l’année se termine avec la neige. Cette année 1944 contient toute dans le mot Libération, mais hélas que de douleurs, que de désespoir a coûté cette liberté reconquise. Cette nuit la place est éclairée, nous ne sommes pas oppressés par la crainte de la Milice et de la Gestapo. Il n’est plus qu’à souhaiter que 45 voit la fin de toutes nos misères.
*****************************
1945
MARQUÉE PAR LA VICTOIRE
(Mon journal)
Une nouvelle année s’ouvre devant nous.
Chacun fait des vœux pour qu’après 44 qui nous apporte la libération, 1945 nous fasse connaître la Paix.
Et la vie continue, monotone. Chacun suit avec intérêt les événements… chacun tremble ou espère… jusqu’au moment où se dessine la Victoire… l’anéantissement des nazis.
Les premiers prisonniers arrivent. C’est une joie infinie. On ne vit plus que pour les nouvelles… on voudrait être plus vieux… Malgré l’écroulement chaque jour plus certain de l’ennemi, tant qu’il vit et se bal, le danger demeure.
Et puis nous avons tant des nôtres là-bas, au cœur de l’Allemagne, sur le Lac de Constance, en Autriche…
Le 7 mars, les enfants déficients de nos deux villes, et ils sont nombreux, partent pour un séjour de trois mois en Suisse où des familles généreuses les hébergeront, les gâteront…
Le 20 mars, le Commandant ThivoIIet est dans nos murs. Il a reçu du Général de Gaulle une magnifique citation.
Le 8 avril, le Général de Gaulle en inspection sur le front des Alpes traverse Bourg-de-Péage.
Vendredi 13. – Emotion générale. Mort de Franklin Roosevelt: les drapeaux sont mis en berne…
Le Pont-Vieux est ouvert à la circulation. Nous revoyons voitures et camions emprunter la côte des Cordeliers. Animation inaccoutumée.
Et, petit à petit, arrivent les grands jours qui vont combler nos désirs et mettre fin à nos inquiétudes.
**
SUR 25, UN SEULEMENT NOUS REVIENT
(Mon journal)
Les dates limites que je me suis tracées comme cadre de cette brochure ne me permettent pas de situer en son temps et d’une manière chronologique la rafle du 30 septembre qui coûta tant de souffrances et même la mort à certains ouvriers romanais. Mais voilà qu’en ces premiers jours de Mai, le retour d’un déporté va me donner cette occasion.
Le 30 septembre 1943, vingt-cinq honnêtes ouvriers « ramassés » par les Boches dans les usines Fénestrier, Sirius et Mossant regagnaient Valence, Montluc, Compiègne d’où quelques familles reçurent des lettres réclamant des vêtements chauds. Puis… plus rien, si ce n’est l’angoisse, l’inquiétude, le désespoir.
Seize mois interminables ont passé… et l’un d’entre eux, 1 sur 25, vient de rentrer. Il s’agit d’Henri Dye, des usines Fénestrier.
C’est allongé dans sa chaise où il repose son corps meurtri et ses membres décharnés que le rapatrié me reçoit. Ses yeux expriment la terreur. A chaque bruit, à chaque éclat de voix il se replie sur lui-même, s’apprêtant à cacher son visage de ses bras, comme pour parer les coups.
Les mains gelées, il fut contraint chaque jour, sur un parcours de 600 mètres de tenir la gamelle bouillante, aussi ses ongles sont tombés, ses doigts sont déformés. Son corps porte les marques de coups de crosses et de manches de pelles. C’était à son départ un homme de 86 kilos, il n’en pèse pas aujourd’hui 40.
Avec un demi litre de soupe claire et de 100 à 300 gr. de pain par jour selon les périodes, il vécut pendant seize mois, sans compter les transferts durant lesquels il restait 4 à 5 jours sans nourriture.
Il n’a pas échappé non plus aux fantaisies des nazis qui consistaient, en plein hiver, à faire lever les déportés la nuit et les laisser au froid, puis à prolonger des heures entières les douches glacées.
Notre brave ouvrier est resté 21 jours au camp de Flusberg, camp d’extermination des Juifs où 15 à 20 détenus tombaient chaque jour sous les brutalités nazies pour ne plus se relever.
C’est le regard fixe, le visage encore contracté que M. Dye nous narre ces souvenirs atroces.
Je l’interroge alors sur ses camarades Romanais, Péageois.
– Sur 25 arrêtés dit-il, j’ai perdu les traces de 17 qui étaient vivants le 25 novembre 1944, mais qui, à ce jour, n’ont pas encore donné des nouvelles à leurs familles ; 7 sont morts de privations et de mauvais traitements… et moi, je suis là, bien amoindri hélas !…
Voilà le bilan de la journée de rafle du 30 septembre 1943 à Romans tel qu’il est possible de le situer en ce premier Mai.
**
LA PRISE DE BERLIN 1er MAI
(Mon journal)
1er Mai : La Radio de minuit annonce : Hitler est mort, l’Amiral Dœnitz le remplace.
3 Mai : La radio de 7 heures annonce : Berlin est tombé mercredi 2 à 15 heures, l’armée d’Italie a déposé les armes. Pour la première fois depuis cinq ans la foule d’autrefois s’est rassemblée pour fêter avec un enthousiasme débordant l’anéantissement du Grand Reich dont le cœur a cessé de battre. A midi, les cloches de nos églises ont sonné, déclenchant dans leur envolée l’allégresse générale.
Les drapeaux ont été déployés, les yeux se sont allumés à la pensée de la seconde journée à venir, celle de la Paix.
Un défilé monstre précédé des drapeaux alliés, de la musique et dans lequel on remarquait les personnalités civiles et militaires des deux villes est salué au passage par une haie interminable de concitoyens enthousiastes. Le soir, sur la place Jules-Nadi noire de monde et illuminée de feux de Bengale, un grand bal réunit dans la joie la jeunesse romanaise.
**
8 MAI : LE JOUR V
(Mon journal)
Et vive la France, a dit d’une voix lourde d’émotion le Général de Gaulle, les sirènes ont mugi, les cloches ont sonné ; la Marseillaise a vibré. En ce jour de couronnement de tous les efforts, de certitude que les sacrifices n’ont pas été vains, notre Jacquemart a sonné l’heure H du départ vers une vie normale… où la liberté chèrement payée s’épanouira dans l’ordre et la justice. Ce soulagement, cet honneur, ces espérances ont justement animé la population d’une débordante allégresse. Mais à Romans l’émotion a côtoyé la joie. Que de visages d’hommes assombris, que de cœurs gonflés à l’évocation des camarades restés là-bas, de ceux qui ne reviendront jamais. Nos prisonniers et rapatriés ont du cœur et le jour de gloire s’est passé pour eux en pensées auprès de ceux qui souffrent encore. Ce fut aussi au cours de la journée le défilé d’épouses, de mères, x venues déposer des fleurs sur les tombes des glorieux défunts. Là de nombreux parents voyaient l’évocation de l’être cher que l’on attend ou de celui que l’on, ne reverra jamais.
Romans renaît cependant, mais cette renaissance ne pouvait s’accomplir sans une pensée douloureuse mêlée à la joie.
**
9 MAI : SECONDE JOURNEE D’ALLEGRESSE
(Mon journal)
La seconde journée d’allégresse a été marquée par des fêtes sportives, un meeting de la victoire précédé d’un défilé avec les principaux groupements et sociétés de la ville et où les prisonniers, les pionniers du Vercors avaient le premier rang.
Le soir, retraite au flambeau, feu de camp, farandoles, bals, monômes, Hitler et Mussolini au bûcher, toutes sortes d’attractions qui enthousiasmèrent la jeunesse.
Ces journées ont été empreintes de dignité et d’émotion. Les veuves et ascendants des maquisards ont déposé une gerbe au Monument aux Morts. Les combattants de 14-18, 39-45 ont été dignement représentés, étendards déployés aux différentes manifestations du souvenir.
Une délégation des pionniers du Vercors a déposé des fleurs au Château de Saint-Nazaire-en-Royans où périrent si cruellement un grand nombre de nos compatriotes dissidents.
Chacun a eu une pensée pieuse pour ceux qui furent les bâtisseurs immortels de cette victoire qui doit avoir un lendemain à la grandeur de leur sacrifice.
**
22 MAI : LES LORRAINS PARTENT
(Mon journal)
Depuis quelque temps Romans se réjouit de l’arrivée de nombreux de ses prisonniers.
Mais alors que le cœur battant de joie elle reçoit à bras ouverts ses propres fils, une tristesse bien compréhensible l’envahit : ses enfants d’adoption la quittent.
La libération, la victoire rappellent les expulsés lorrains si nombreux dans nos murs, vers leur chère patrie. Cinq ans de la vie commune, cinq ans de semblables angoisses et d’espoirs partagés dans une cité comme la nôtre, voilà de quoi nouer des liens de respectueuse amitié.
Que de chaleureuses poignées de mains échangées, que de promesses de retour.
Il faut voir tous ces garçonnets et fillettes venus bébés et repartant enfants raisonnables, petits romanais dans l’âme, ne connaissant pas comme leurs parents et leurs ainés l’attrait du sol natal et s’accrochant au cou du petit camarade romanais ou péageois.
Nos écoliers, nos étudiants ont vu leur effectif réduit, car lorrains et lorraines ont déjà regagné le pays natal, le courrier s’échange entre la Moselle et Romans.
Il reste le souvenir, l’affection née des années de misère, la sympathie réciproque qui forme le trait d’union entre Romans et la Lorraine retrouvée.
Finie cette année de terreur. Fini ce cauchemar ! La liberté est retrouvée.
Dans la clandestinité, dans le combat, dans la souffrance, aux portes du Vercors martyr, dans nos deux villes, berceau de la Liberté, les Romanais et Péageois ont marché serrés côte à côte et fait de notre petite Patrie, une cité blessée mais une cité glorieuse. On ne pouvait laisser dans l’oubli cette page d’histoire. On ne pouvait laisser s’effacer dans le souvenir de nos enfants, les épisodes de cette année terrible.
Romans, le 6 Juin 1945
(Et ces lignes s’achèvent alors que nos Pionniers s’apprêtent à célébrer librement l’anniversaire du débarquement de Normandie et l’Appel du Vercors).